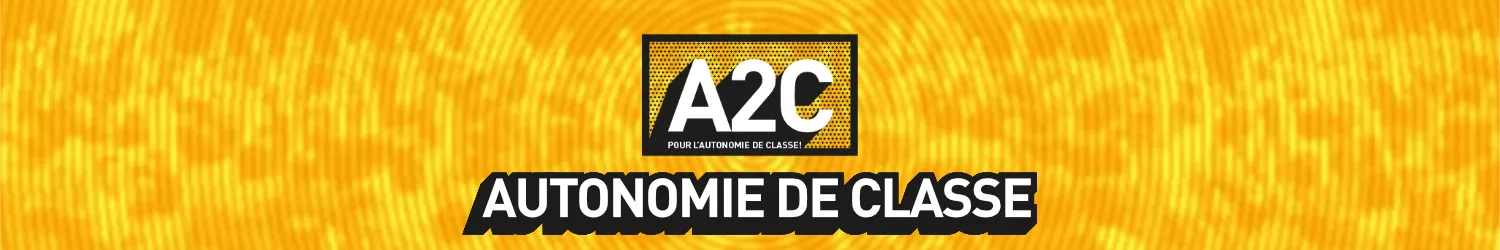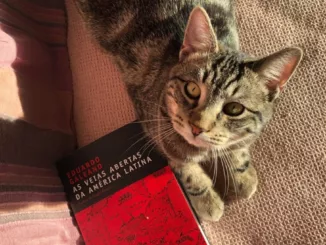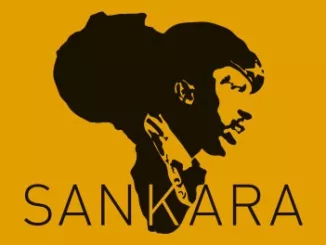Dans les milieux militants, il semble être évident de se déclarer anti-capitaliste : le capitalisme provoque les guerres, la misère, la catastrophe écologique, et ses imbrications avec les oppressions racistes et patriarcales ne sont plus à démontrer. Pourtant, peu sont celleux qui partent des mécanismes internes du capital pour en comprendre les conséquences. Ce mode de production nous semble tellement normal, indépassable, qu’on ne prend même pas la peine de chercher à le comprendre.
Les Cahiers d’A2C #17 – juin 2025
En premier lieu, le capitalisme est un système économique basé sur le travail salarié et qui tend vers la division de la société en deux classes sociales, c’est-à-dire des personnes qui ont la même place dans le processus de production par rapport à un autre groupe.

D’un côté, la classe capitaliste est la classe dominante, qui acquiert cette domination par l’exploitation de notre classe, en contrôlant les moyens de production. « Classe dominante » n’est pas juste une manière de dire qu’iels sont riches, ça met en lumière le pouvoir qu’iels ont dans la société toute entière, y compris en dehors de leur entreprise. Par exemple, la campagne Stop Arming Israel met en lumière qu’une poignée d’entreprises en France font le choix de vendre des armes, des composants électroniques ou du matériel de surveillance à Israël, qui serviront dans la colonisation et le génocide des Palestinien·ne·s. Dans une société où l’ensemble des rapports sociaux sont capitalistes, les structures étatiques et juridiques n’y échappent pas. La classe dominante s’organise pour maintenir ses profits et légitimer son pouvoir.
Un incontournable retour à l’économie marxiste
Et en face, les marxistes parlent de la classe travailleuse. Est-ce une question de revenu, de culture, d’identité, d’éducation ? Bien sûr, tous ces critères en disent beaucoup sur les conditions de vie et sur les capacités de résistance de notre classe. Par contre, ils sont insuffisants pour comprendre comment fonctionne la société dans son ensemble.
En fait, l’immense majorité de la population, dans toute sa diversité, fait partie de la classe travailleuse. Pour définir cette classe, il faut revenir à la théorie de la valeur de Marx : dans le capitalisme, il y a des marchandises, qui peuvent être de toutes les formes, du pain au chocolat aux services de soins privés. Ces marchandises peuvent toutes être échangées les unes avec les autres, et ce qui permet de les mesurer ensemble, c’est le temps de travail nécessaire pour les produire (celui passé à créer la marchandise, à produire les matières premières, à transporter la marchandise vers le magasin, à la vendre, etc). Ainsi, la grandeur de valeur d’une marchandise, qui s’exprime par son prix, représente l’ensemble du travail qui a été nécessaire pour produire cette marchandise.
Et dans un système capitaliste, tout est une marchandise, notamment notre force de travail, c’est-à-dire le temps et l’énergie mis à disposition de l’employeur·se pendant nos heures de travail. Donc le patron·ne l’achète tout comme iel achèterait des matières premières ou de l’électricité. La question devient donc « combien coûte cette marchandise ? », car notre force de travail a une valeur, donc un prix, le salaire. Mon salaire est la quantité de travail qui est nécessaire pour reproduire ma force de travail : en gros, le salaire est ce qui sert à financer ce dont j’ai besoin pour être capable de retourner au travail le lendemain : payer mon loyer, à manger, ma carte Navigo et mon abonnement Netflix.
Sauf que, en une journée de travail, nous produisons plus que ce qui est nécessaire à notre survie. Si mon salaire est de 100 euros par jour (= j’ai besoin de 100 euros par jour pour financer la reproduction de ma force de travail), et si je travaille pendant 8 heures, mon employeur·se tirera de mon travail non pas 100, mais environ 150 euros ! Donc je lui rapporte plus que je ne lui coûte.
En France, les données de l’INSEE nous montrent qu’en 2022, sur l’ensemble de la valeur produite par les travailleurs, 65% leur a été reversé en salaire. Au reste, il faut retirer l’amortissement des machines ou le loyer du lieu de travail. Mais à la fin, pour chaque heure que nous travaillons, environ 6% de la valeur produite est accaparé et devient du profit.
Cela a une implication majeure sur la manière dont les inégalités sociales se forment : certain·e·s sont pauvres non pas malgré la richesse d’autrui : ce serait l’hypothèse – fausse – d’une mauvaise distribution des richesses. Mais certain·e·s sont pauvres et d’autres sont riches parce que ce derniers s’enrichissent sur notre dos. Ce mécanisme n’est pas dépassable sous le capitalisme car il est au cœur de la production du profit : les capitalistes individuellement ne peuvent pas choisir de ne pas exploiter les travailleur·se·s, parce que les différentes entreprises sont en concurrence les unes avec les autres et ne peuvent remporter des parts de marché qu’en proposant plus pour moins cher. Les capitalistes doivent donc faire augmenter la productivité du plus qu’iels peuvent : étirer la durée du travail, augmenter les cadences, utiliser des machines plus performantes, fliquer les travailleur·se·s… Par exemple, dans les entrepôts Amazon, le travail est distribué à l’aide d’algorithmes. Ce système électronique suit la productivité de chaque individu et Amazon licencie toutes celles et ceux qui ne parviennent pas à atteindre la niveau de productivité attendu, environ 160 colis par heure (en progression de 60% depuis 2019 !). Résultat, un·e salarié·e d’Amazon France sur cinq y est atteint de troubles musculo-squelettiques.
Dans quelle classe es-tu ?
La majorité d’entre nous appartenons au prolétariat, soit parce que nous travaillons pour quelqu’un, soit parce que nous allons bientôt le faire, soit parce que nous l’avons fait dans le passé ou que nous en sommes exclu.e.s mais ne pouvons bénéficier de rentes issus de l’exploitation d’autrui.

L’appartenance de classe ne dépend pas du revenu puisque celui-ci est toujours issu de notre propre travail, de la valeur que nous avons créée pendant notre journée de travail. Les salaires plus élevés sont souvent dus à une forte productivité, des difficultés de recrutement ou des acquis de luttes. La forme juridique salariale importe peu, comme on le voit avec les chauffeur·se·s Uber et autres faux micro-entrepreneur·se·s. Ce n’est pas non plus une question d’identité, de se sentir appartenir à la classe ouvrière : le marxisme est avant tout une théorie pour comprendre les mécanismes à la source de l’exploitation et élaborer des stratégies pour y mettre fin. Quelle que soit notre identité, notre appartenance de classe a un impact sur nos occupations, santé, logement, et sur les capacités de perpétuer ou de se protéger face à une oppression. Une distinction entre le secteur public et le secteur privé est souvent faite : dans un secteur public non marchand (comme l’éducation, la culture, la santé), les travailleur·se·s n’ont pas de patrons : font-iels partie de notre classe ? En effet, personne n’extrait, techniquement, de profit de leur travail. Par contre, ces travailleur·se·s produisent bien de la valeur en travaillant, puisqu’ils produisent un service qui remplit un besoin et qui est donc financé par l’État. De plus, iels permettent à d’autres personnes de générer du profit, par exemple en formant ou soignant d’autres travailleur·se·s. Par ailleurs, les conditions de travail des fonctionnaires sont souvent similaires à celles des travailleur·se·s du privé, puisque l’État, leur employeur, cherche très logiquement à faire augmenter leur productivité.
Le cas des managers et des flics est intéressant parce qu’il montre que la classe n’est pas une caractéristique figée : certains groupes sociaux ne font pas partie de notre classe, même s’ils produisent de la valeur en travaillant pour quelqu’un d’autre, et même si iels sont précaires, car leur position dans la production est de nous faire travailler, soit en organisant la production et notre travail, soit en réprimant notre résistance.
Hétérogénéité de classe
Notre classe n’est pas homogène : elle est constituée de personnes de toutes origines, identités de genre, religions… Mais même si tou·te·s ont le même intérêt à l’amélioration de leurs conditions de vie, certains groupes sont plus avancés que d’autres, avec une conscience de classe plus ou moins affirmée, certaines fractions du prolétariat sont réacs, racistes, sionistes, homophobes, certaines adhèrent aux différents partis bourgeois ou s’y opposent… Ça ne signifie pas qu’on peut militer avec n’importe qui parce qu’on est de la même classe, au contraire, la lutte se fait avec les personnes ayant la conscience la plus juste de leur position de classe et les plus cohérentes et consistantes quant à leurs actiosn. Ça veut surtout dire qu’il faut refuser les visions qui fétichisent la classe ouvrière, qui reposent toujours sur une simplification des rapports sociaux et de la lutte des classes.
A quoi ça sert ?
Marx écrivit en 1844 que « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c’est de le transformer. » À A2C, nous militons au quotidien parce que nous tirons de notre analyse du capitalisme des pistes pour le renverser, et si nous affinons nos analyses c’est pour nous permettre de militer de la manière la plus efficace.
Notre classe a non seulement intérêt à ce que ce système soit renversé, mais c’est elle seule qui a la capacité de le faire.
Qui d’autre ?
Certains parlent du peuple, des masses, des « gens », qui tou·te·s ensemble pourraient abattre le capitalisme. Sauf que c’est un peu flou : ces gens, de quelle classe font-iels parti.e.s ? Si cela inclut des capitalistes cela ne peut que nous limiter. Par exemple, les petits patrons ne luttent souvent que parce qu’iels veulent s’enrichir individuellement et non pour s’opposer au fonctionnement inégalitaire du système. De même, si des prolétaires se mettent en mouvement sans se concevoir comme tels, la lutte ne peut dépasser un certain point et se condamne à stagner, en témoigne les gilets jaunes, qui ont occupé.e.s la rue et se sont confronté.e.s à la répression d’État en tant que citoyen.e.s ou personnes en colères, mais n’ont pas amené la lutte à l’intérieur des lieux de travail. En fait, ces « masses » peuvent protester, exprimer leur colère, de manière très véhémente. Mais les masses ne peuvent rien construire tant qu’elles ne s’organisent pas en tant que classe pour prendre en charge la société.
Est-ce l’identité ou le vécu qui permet de combattre une oppression ? Être discriminé.e ne donne pas nécessairement le pouvoir de lutter contre le système d’oppression. Par exemple, subir de la transphobie ne donne pas plus de capacités aux trans qu’aux cis pour lutter contre elle.
Par contre, la classe travailleuse a la pouvoir de renverser le système, contre l’exploitation et toutes les oppressions. Déjà, elle se rebelle. Partout, des mécontentements explosent, des grèves éclatent, les travailleur·se·s se révoltent contre l’exploitation, les conditions de travail, et pour la hausse des salaires. Iels n’ont rien à perdre parce qu’iels n’ont aucun privilège à consolider, parce qu’iels ne possèdent rien. C’est une première différence entre Marx et Engels et ceux qui les ont précédés, qu’on appelait les socialistes utopiques : ces derniers voyaient les travailleur·se·s comme des victimes à sauver, et Marx et Engels ont vu en eux des acteur·ice·s de leur propre destin.
Par ailleurs, la classe travailleuse est collective et globalisée: l’immense majorité de la population mondiale qui travaille le fait par le biais du travail salarié. On parle de milliards de personnes. En excluant les employeurs étatiques (donc les armées et les services de santé), les 10 entreprises qui emploient le plus de personnes dans le monde emploient près de 10 millions de personnes, et encore c’est sans compter la sous-traitance. Le plus gros employeur, Walmart, emploie plus de 2 millions de personnes, autant de gens qui ont tou·te·s le même ennemi de classe, Jim Walton. Rien qu’en France, les 243 plus grosses entreprises emploient un tiers de la population active. Ainsi, chaque marchandise a été produite par le biais du travail de milliers voire des centaines de milliers de personnes, dans le processus d’extraction des matières premières, de fabrication l’objet, du transport, de la vente etc.
Le caractère collectif, c’est aussi sur le même lieu de travail : pour travailler, et pour résister, nous sommes obligé.e.s de collaborer avec nos collègues. La résistance prend nécessairement une forme collective, parce qu’il ne peut y avoir aucun espoir d’affranchissement à l’échelle individuelle.
Et surtout, les travailleur.se.s, en tant que classe, font tourner la société. Cela nous donne un pouvoir immense, à la fois de refuser de travailler tant qu’on obtient pas gain de cause, mais aussi d’utiliser notre position stratégique dans la production pour lutter : c’est cela qui se passe quand la CGT Énergie coupe l’électricité de sièges d’entreprises ou à des élus ; c’est ce qui se passe quand des travailleur·se·s hommes et femmes se mettent en grève pour l’obtention de congés menstruels. Et justement, en s’organisant, les travailleur·se·s donnent à voir à quoi ressemblerait une société sans patrons, une société dans laquelle à toutes les échelles, les décisions sont prises par toutes et tous.
À plus grande échelle, comment parler du pouvoir de la classe ouvrière sans évoquer la révolution russe de 1917 ? Le 8 mars 1917, jour de lutte pour les droits des travailleuses, des grèves éclatent en Russie dans les centres ouvriers, qui prennent rapidement une très large ampleur, en Russie et en Europe. La révolution russe met fin à une guerre mondiale dévastatrice, rend l’avortement et l’homosexualité légales pour la première fois dans l’histoire, montrant également la nécessité d’un parti révolutionnaire pour organiser les travailleur·se·s les plus déterminé·e·s.

La classe travailleuse s’y est organisée en soviets, le mot russe pour « conseil » : en pratique, les travailleur.se.s en grève dans chaque usine envoyaient des délégués au soviet de la ville qui s’agrandissait chaque jour, au fur et à mesure que de nouvelles usines étaient en grève. Les soviets, à Petrograd en particulier, ont rapidement représenté le pouvoir ouvrier, au point de renverser en quelques jours le Tsar dont la dynastie était au pouvoir depuis des siècles, et quelques mois plus tard le gouvernement bourgeois de Kerenski qui l’avait remplacé. Les travailleur·se·s se sont organisé·e·s entre eux pour prendre des décisions démocratiques, organiser la vie quotidienne, arrêter la guerre et gérer la production. Dans certaines usines, la direction a été licenciée par les ouvriers qui s’en emparaient pour la gérer eux-même. A l’échelle du plus vaste pays du monde et pendant plusieurs années, avant la contre-révolution stalinienne, cette révolution a montré que quand les travailleur.se.s agissent en tant que classe, pour eux même et contre la classe dominante : iels peuvent tout transformer.
À A2C, quand on parle de renverser le capitalisme, c’est cela que nous avons en tête : quand les travailleur·se·s agissent en tant que classe, iels sont en capacité de s’emparer de tout ce qui permet de faire tourner la société : entreprises, industries, internet etc. Et en construisant notre propre société sur les ruines de l’actuelle, ce seront les classes sociales elles-mêmes qui disparaîtront.