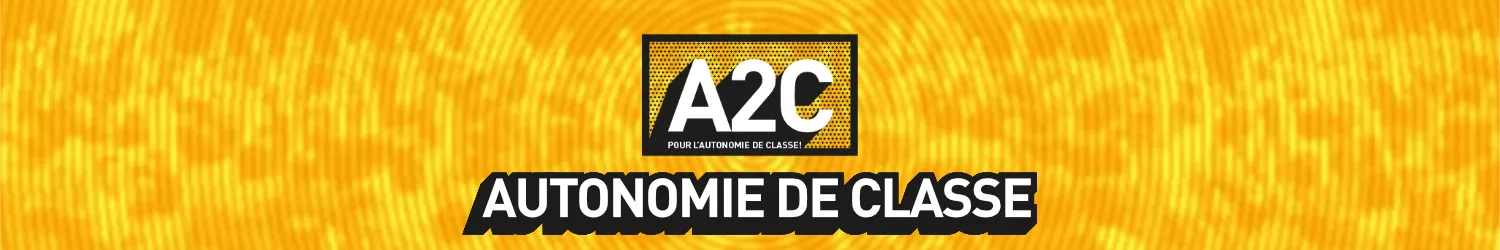Les syndicats restent, malgré leurs faiblesses et contradictions, la principale force organisée de la classe des travailleuses et des travailleurs. Capables de mobilisations massives, ils se heurtent toutefois à des limites internes : bureaucratisation, orientation réformiste, refus d’encourager l’auto-organisation. Comment, dès lors, y intervenir pour faire avancer les perspectives révolutionnaires ? Si l’on part de l’idée, actualisée, de Marx, que « l’émancipation des travailleurs et travailleuses sera l’œuvre des travailleurs et travailleuses elles et eux-mêmes », alors il faut être dans les syndicats et contribuer à les construire.
Les syndicats, principale force organisée de notre classe
Qui, en 2023, a mis des millions de salarié·es en grève et jusqu’à 3 millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites ? Les syndicats ! Qui, après la dissolution de l’Assemblée, a rassemblé 800 000 personnes contre le danger fasciste ? Encore les syndicats !
Malgré un recul historique de la syndicalisation – de 30-35 % au sortir de la Seconde Guerre mondiale à moins de 10 % aujourd’hui – les organisations syndicales regroupent encore près de 2 millions d’adhérent·es : la CGT et la CFDT revendiquent plus de 600 000 membres chacune, FO environ 380 000, et Solidaires, la FSU, l’UNSA, la CFE-CGC et la CFTC autour de 100 000 chacune.
La présence syndicale reste cependant très inégale : forte dans les transports, l’éducation ou l’automobile, très faible dans le commerce ou le tourisme, où la main-d’œuvre est souvent féminisée et racisée, et où les salaires et conditions de travail sont les plus dégradés. Mais même dans ces ces « déserts syndicaux », les luttes récentes – femmes de chambre de l’hôtel Ibis, travailleurs sans-papiers de Chronopost – ont montré que l’outil syndical peut devenir une arme dès que la volonté de se battre existe. Quand un conflit éclate, c’est vers les syndicats que l’on se tourne.
Les syndicats ne se contentent pas de mobiliser pour des manifestations : ils interviennent au cœur de l’exploitation, dans les entreprises et les secteurs d’activité pour faire respecter les droits des salariés. Ils organisent la grève, ce moment où on se libère momentanément de nos chaînes, ce moment où s’ouvre la possibilité de s’organiser collectivement et d’agir pour nous-même.
Malgré un faible taux de syndicalisation, la France conserve un niveau de grève parmi les plus élevés d’Europe (128 jours pour 1 000 salarié·es sur 2010-2019, contre 18 à 57 ailleurs). La quasi-totalité de ces grèves sont appelées par les syndicats. Les mouvements contre la réforme des retraites ont été parmi les plus massifs :
2010 : 364 jours/1 000 salarié·es, 3 millions de manifestant·es.
2019 : 161 jours/1 000, plus de 1,5 million de manifestant·es.
2023 : 171 jours/1 000, un mouvement de plus de 4 mois, 13 journées nationales de grève et de manifestation, parfois supérieures en nombre à 1995 et 2010. Ce dernier mouvement a vu des manifestations dans plus de 300 villes, des cortèges sauvages et un soutien de plus de 70% de la population. Il a créé une crise politique toujours en cours.
Cela ne veut pas dire que la lutte de classe, se résume au syndicalisme : le mouvement des Gilets jaunes ou la révoltes des quartiers après l’assassinat de Nahel ont porté des luttes intenses contre l’exploitation et l’oppression en dehors des syndicats. Mais même dans ces deux situations, les syndicats ont eu un rôle très important – hélas en négatif – en condamnant les violences plutôt qu’en généralisant la lutte. Le syndicat est donc incontournable si on veut agir au sein de notre classe pour son émancipation.
Des stratégies qui mènent à la défaite.
Pourtant les syndicats nous mènent le plus souvent à la défaite comme l’a vu lors des derniers mouvements.
Les syndicats sont fondamentalement des organisations qui négocient nos conditions d’exploitation dans le cadre du capitalisme, elles ne cherchent pas à briser l’exploitation. Les directions syndicales cherchent à s’asseoir le plus rapidement possible autour de la table de négociation pour tenter d’alléger ou de ne pas trop alourdir nos chaînes. Et ces directions pèsent de tout le poids de la bureaucratie.
La bureaucratie est inhérente au développement du syndicalisme de masse, parce qu’elle assure, par le permanentât ou les délégations, la continuité nécessaire au fonctionnement du syndicat par sa participation aux instances dites de négociation, hors des grands mouvements sociaux. Elle se trouve ainsi dans une position sociale particulière : ni patron, ni directement soumis aux conditions de travail qu’elle négocie. Pour garder leur rôle d’interlocuteurs, les directions doivent à la fois conserver la confiance des salarié·es et celle du patronat. Si les directions sont traversées par des clivages, si bien sûr on préfère les orientations de gauche à celles de droite, la bureaucratie dans son ensemble adopte néanmoins une position réformiste.
Le conclave pathétique sur les retraites a montré la capacité des syndicats dit « réformistes », la CFDT en tête, à s’asseoir sur les revendications du mouvement, en acceptant les 64 ans. Mais qu’ont fait les autres syndicats dit « de transformation sociale » ? Rien de sérieux. Quelques appels pathétiques sans perspective en avril ou mai dans la Fonction publique, un appel tout aussi pathétique de la CGT sur les retraites en juin. Alors qu’en décembre dernier la grève de la Fonction publique, particulièrement massive dans l’éducation, avait fait reculer le gouvernement Barnier sur les 3 jours de carences, à la veille de sa chute. Ils en tirent maintenant la conclusion que les salarié.es ne sont pas prêt.e.s à se battre !
De par leur positionnement réformiste, les directions voient fondamentalement les choses par en haut, non depuis l’auto-activité des millions de de salariés en lutte mais depuis l’activité parlementaires et c’est pour cela qu’elles craignent par-dessus tout la crise politique. Pendant le mouvement des retraites, la stratégie intersyndicale a consisté à organiser un mouvement d’expression massif plutôt qu’une confrontation directe : calendrier calé sur le Parlement et le Conseil constitutionnel, mobilisation envisagée avant tout comme pression institutionnelle. Les directions n’ont jamais cherché à encourager l’auto-organisation et les AG de luttes, et la reconduction a été laissée au bon vouloir local sans impulsion militante forte.
Il y a une différence notable entre argumenter qu’il faut reconduire la grève, en délégant des militants pour relayer les appels pour convaincre et motiver des équipes et dire « faites comme vous le sentez » ! C’est pas qu’il ne le peuvent pas : quand il s’agit des élections professionnelles, les directions sollicitent de nombreux militants pour faire des rappels téléphoniques à tous les syndiqués pour les faire voter ; on n’a jamais vu cela pour une grève. C’est qu’il ne le veulent pas !
Et il y a bien pire. Quand la mobilisation devient générale et radicale, quand des pans massifs du salariat commencent à se poser la question de rompre les chaînes de l’exploitation plutôt que d’en négocier le poids, alors les bureaucraties mettent toute leur énergie pour stopper la grève comme en juin 36 et en mai 68.
Construire un syndicalisme par en bas
Pour dépasser cette contradiction, il faut chercher à construire l’activité syndicale à la base contre la nature même du syndicat : pas en tant qu’outil de négociation mais en tant qu’outil qui permet l’auto-organisation et l’auto-activité des travailleur.se.s. Il faut organiser les grèves non pas en tant que lutte économique mais en tant que lutte politique.
Ce que craignent les patrons dans une grève c’est n’est pas tant l’impact économique sur leurs profits – ils ont beaucoup en réserve, c’est la perte de contrôle, parce que le mouvement prend un caractère politique en remettant en cause leur pouvoir sur la production.
Ainsi quand les patrons d’une boite annoncent une fermeture ou des suppressions de postes, l’enjeu n’est pas de négocier pour limiter la casse, ou obtenir des meilleurs conditions de licenciement, mais de refuser en bloc tous les arguments financiers pour justifier la fermeture, de refuser toute suppression de poste et d’impliquer le plus grand nombre dans la grève et l’auto-organisation pour poser la question du contrôle de la production par les travailleur.se.s.
Il y de nombreux exemples de telles luttes qui sont allées très loin dans l’auto-organisation, dans la radicalité et la confiance collective : pendant les grandes périodes de grèves générales comme en juin 36 et mai 68, mais aussi chez LIP en 1973 ou chez les Conti en 2009. Cela ne signifie pas qu’on gagne sur tout, qu’à un moment, on ne va pas négocier, mais cela se fera sur la base d’un rapport de force et d’une confiance collective construite dans la lutte.
A une modeste échelle locale, la lutte menée au lycée Voltaire à Paris en 2007 contre la suppression de deux postes a permis sur le long terme d’organiser un collectif solide. Animés par des militant.e.s qui partageaient le même soucis de la lutte par en bas, la grève et le blocage ont paralysé l’établissement pendant 15 jours, rassemblant quotidiennement près de 70 collègues en AG – la quasi totalité de ceux qui travaillaient pour discuter démocratiquement de la stratégie à mener et de la reconduction. Nous n’avons pas seulement gagné le maintien des 2 postes, mais également une énorme confiance collective et un fonctionnement systématique en AG mensuelle de tous les personnels qui dure depuis près de 20 ans. Dans ce type de dynamique, les divergences d’appareils syndicaux passent au second plan : l’unité et l’action priment ; des liens se créent avec d’autres établissements et d’autres secteurs pour se soutenir, partager les expériences et les analyses et tenter de généraliser la lutte.
Même si de telles dynamiques ne sont pas tout le temps envisageables, il y a toujours des moyens d’actions collectifs pour prendre position, donner confiance et rester soudé.e.s. Quelques exemples récents dans le secteur de l’éducation en témoignent. Une intense répression contre les équipes militantes a accompagné la politique de Blanquer au ministère de l’Education nationale. La campagne de solidarité avec Kai Terada, un collègue de Sud éducation déplacé de force de son établissement a permis de développer une solidarité exemplaire : affichage de banderoles et photos collectives, pétitions et motions d’AG dans les établissements… Elle a donné la confiance face à la répression du ministère et a finalement permis d’associer des collègues de centaines d’établissements à la victoire de Kai.
Pendant le mouvement des retraites, Darmanin préparait sa loi raciste, mais les directions syndicales se sont tu. Pour les dirigeants syndicaux c’est une question « politique » qui se règle au parlement. Quand ils se sont finalement mollement réveillés, il était trop tard, Darmanin avait fait voter sa sale loi avec les voix du RN qui exultait. Mais une campagne de solidarité a débuté autour du collectif des mineurs du parc de Belleville qui avait entamé une lutte fantastique : campagne de photos collectives de solidarité dans les bahut, cortège d’enseignants à leur côté dans les manif contre la loi. Dans la suite un collectif syndical s’est organisé en très grande partie grâce à Sud éducation, mais englobant maintenant tous les syndicats. Il prépare une campagne de solidarité à la rentrée scolaire.

S’organiser en tant que révolutionnaire
Si l’on veut agir en tant que révolutionnaires dans et pour notre classe, la présence active dans les syndicats et dans leur construction est donc incontournable. Mais par leur nature même les syndicats ne seront jamais des organes révolutionnaires. En saisissant cette contradiction par en bas, l’activité des révolutionnaires au sein des syndicats offre la possibilité d’accroître la confiance collective dans la lutte, dans la force révolutionnaire de notre classe.
Mais il faut garder en tête que la lutte de classe est tout sauf linéaire. Il y des vagues, des creux, des mouvements sur la gauche et sur la droite. Tout cela peut désorienter voire démoraliser. C’est pourquoi qu’il nous faut des boussoles. Elles nécessitent une analyse collective partagée de la situation globale, des forces et des faiblesses du mouvement. Ces boussoles ne tombent pas du ciel, elles s’élaborent se testent collectivement. C’est pour cela qu’à A2C nous pensons qu’il faut non seulement s’impliquer dans les syndicats mais aussi de façon autonome.
Nicolas Verdon (Paris 20ème)