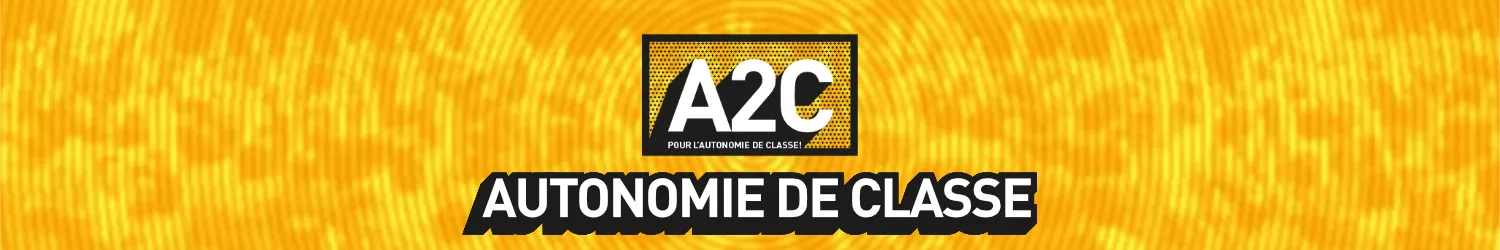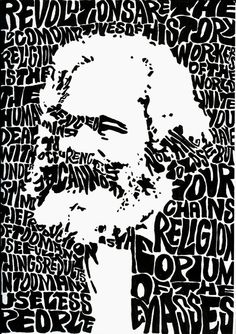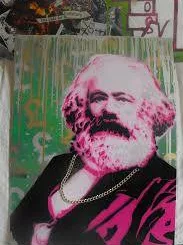L’élection de Trump aux États-Unis marque un tournant géopolitique et stratégique majeur. Un des aspects les plus éclatants en est la façon dont Trump promeut une politique impérialiste brutale pour les États-Unis, faite de menaces économiques, de retournement d’alliances historiques, voire de menaces de conquête pure et dure.
Les Cahiers d’A2C #17 – juin 2025
L’objectif de cet article est triple :
– rappeler les déterminants économiques de ce bouleversement stratégique ;
– analyser ce qu’il contient de continuité et de rupture par rapport à la période précédente ;
– anticiper les arguments qui vont se développer dans notre classe et la manière de les contrer.
Les racines économiques de l’inflation
Dans le capitalisme, l’économie ne permet pas de tout expliquer ni de tout comprendre, mais rien ne peut être expliqué sans avoir en tête la toile de fond économique sur laquelle se fait la politique.
Pour comprendre le phénomène Trump et ses conséquences sur l’impérialisme, il nous faut remonter à la crise financière de 2008. Lors de cette crise, la phase néolibérale du mode de production capitaliste a entamé son agonie. En effet, la doctrine néolibérale stipulait que la marchandisation croissante de l’économie et sa dérégulation devaient à la fois apporter la paix entre les peuples et la stabilité économique du système. Par exemple, le prix Nobel d’économie Robert Lucas, pilier de la contre-révolution néolibérale, expliquait ouvertement en 2003 :
« Le problème central de la prévention des dépressions a été résolu dans toutes ses dimensions pratiques et l’a été pour plusieurs décennies. »
Or, la crise de 2008 a tiré une première balle dans le cœur de ces croyances. En effet, ni la marchandisation à outrance ni la dérégulation ne sont en mesure d’empêcher les crises du système capitaliste. En réalité, la phase du néolibéralisme a simplement réussi à stabiliser les taux de profit. Ce taux, qui était de 10 % sur la période 1950–1967, a chuté à 7 % entre 1968 et 1980, et s’est maintenu autour de cette valeur jusqu’en 2008.
Cette stabilisation des taux de profit moyens a notamment été rendue possible notamment grâce à la transformation des masses paysannes chinoises en ouvriers et ouvrières industrielles. L’achèvement de ce processus a eu deux conséquences importantes : la reprise de la baisse tendancielle du taux de profit, et l’avènement de la Chine comme première puissance industrielle du monde. En 2018, la Chine représentait 28 % de la production industrielle mondiale, contre 16 % pour les États-Unis.
Par ailleurs, cette crise n’a été surmontée que par l’intervention directe des États dans le système économique. En Chine, cela s’est traduit par des politiques massives d’investissement. Dans les pays de l’Ouest, les pays dits développés ont mené des politiques de rachat des dettes pourries par leurs banques centrales. S’en est suivie la prolifération d’entreprises zombies, à peine rentables et prêtes à mourir au premier choc venu.
Enfin, les trusts capitalistes et leurs États nationaux ont eu recours à l’utilisation de taux d’intérêt historiquement faibles pour réaliser des opérations de fusions-acquisitions à un rythme deux fois plus soutenu qu’avant la crise, engendrant des groupes monopolistiques gigantesques.
Le coup de grâce de ce mode de production a été la crise du COVID. Là encore, face à la pénurie de masques et de matériel, ce n’est pas la soi-disant efficacité des marchés qu’on a vue se déployer pour résoudre ces problèmes, mais bien l’intervention directe des États et de leurs forces de police pour aller réquisitionner et voler les masques sur les tarmacs d’aéroports.
Par ailleurs, les États ont encore injecté des tonnes d’argent dans l’économie, ce qui a de nouveau fait exploser le nombre d’entreprises zombies – et donc de surcapacités productives – et de monopoles. À ce propos, la crise inflationniste a notamment été créée par ces groupes monopolistiques qui ont augmenté leurs prix sans craindre de se faire piquer des parts de marché par la concurrence.
L’impérialisme américain face à la concurrence chinoise
Finalement, la situation économique au moment de l’élection de Trump est caractérisée par :
des taux de profit historiquement bas et des surcapacités productives gigantesques.
Ces deux éléments, ensemble, rendent inévitables des faillites d’entreprises en très grand nombre. Reste à savoir où ces faillites vont se produire et qui va payer l’essentiel de cette crise. Normalement, seules les capacités productives les plus importantes et les plus modernes devraient résister à cette « purge » – c’est-à-dire principalement les entreprises chinoises.
Cependant, les choses sont plus complexes à l’heure actuelle, car si la Chine est incontestablement la plus grande puissance industrielle, les États-Unis restent la plus grande puissance politique et militaire. Les États-Unis sont donc en mesure de combattre, par les armes et par leur capacité d’influence, un processus économique qui évolue en leur défaveur.
C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il faut interpréter la folie spéculative autour des entreprises travaillant sur l’IA. En effet, la principale promesse – rien ne dit qu’elle soit réaliste – de cette technologie est une hausse spectaculaire de la productivité du travail, soit la possibilité pour le pays qui développera les meilleurs outils dans le domaine de posséder l’outil industriel le plus avancé, le plus productif, et donc de ne pas subir la destruction des surcapacités.
Dans le même temps, comme la guerre en Ukraine et le génocide à Gaza l’ont montré, l’IA va devenir incontournable sur le champ de bataille.
La guerre commerciale et les droits de douane
Mais, comme l’a souligné J.D. Vance, la puissance militaire découle de la puissance industrielle. Par conséquent, sans réindustrialisation massive des États-Unis, la Chine deviendra également, à moyen terme, la première puissance militaire. Or, le principal moteur du changement de doctrine sur les droits de douane aux États-Unis est précisément la volonté de réindustrialiser.
Enclencher un processus de réindustrialisation – c’est-à-dire créer de nouveaux moyens de production – dans un contexte global de surproduction industrielle, nécessite de rendre les investissements aux États-Unis encore plus favorables pour les capitalistes qu’ils ne le sont déjà, ce qui n’est pas peu dire dans un État quasiment dépourvu de tout mécanisme de solidarité.
Une des alternatives serait d’affaiblir le dollar face aux autres devises afin de rendre les exportations américaines moins chères à l’international.
Mais la dette abyssale des États-Unis n’est soutenable que parce que le dollar est une valeur refuge, stable, prisée par le monde entier. Si le dollar venait à être dévalué, la demande internationale en monnaie états-unienne pourrait diminuer, les bons du Trésor pourraient ne pas trouver preneur, et les États-Unis faire défaut sur leur dette – ce qui serait un cataclysme économique sans précédent en période de (relative) paix.
Finalement, la seule solution encore actionnable par l’administration Trump est celle des droits de douane tous azimuts, censés renchérir les importations aux États-Unis.
Les effets de ces droits de douane sur la réindustrialisation sont très incertains : cela pourrait simplement nourrir un phénomène inflationniste, déjà difficilement supportable par une grande partie de la population, avant même que la première usine soit construite, ou encore entraîner des pénuries de différents matériels.
Par conséquent, il y a fort à parier que non seulement ces droits de douane ne permettront pas aux États-Unis de rester la seule puissance hégémonique, mais qu’ils risquent de créer une nouvelle crise économique qui viendra s’ajouter à toutes les autres.
Le capitalisme est dans une phase de crise avancée, c’est-à-dire dans une phase où toutes ses contradictions sont en tension, et dans laquelle plus aucun levier entre les mains des classes dirigeantes ne peut être actionné sans ajouter de la crise à la crise.
Aussi, dépasser le capitalisme est une urgence vitale, et l’alternative entre « socialisme ou barbarie », posée par Rosa Luxemburg, est plus que jamais d’actualité.