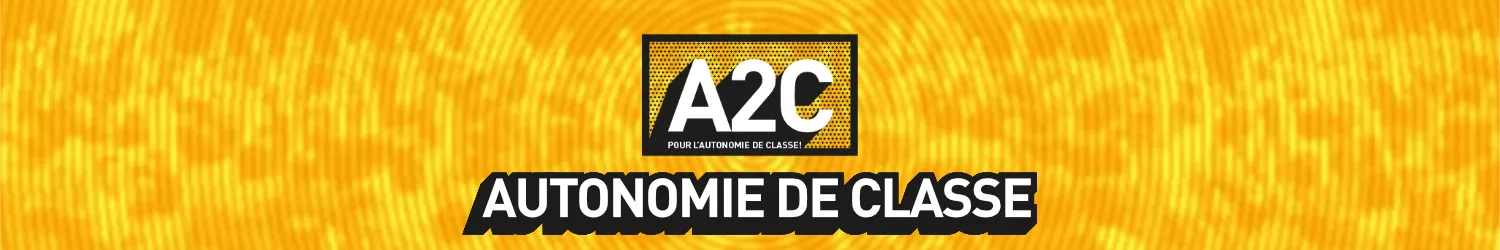Le 22 mars a été la mobilisation la plus forte jamais organisée en France autour de la journée internationale contre le racisme du 21 mars. Qu’est-ce que ça nous dit ? Qu’est-ce que ça ouvre ?1
Les Cahiers d’A2C #17 – JUIN 2025
Plus de 500 organisations, locales et nationales, ont appelé à manifester à l’appel de la Marche des Solidarité et des Collectifs de sans-papiers.
Des manifestations ont eu lieu dans au moins 200 villes et villages, dans les métropoles comme les campagnes.
Ces manifestations ont été, partout, beaucoup plus nombreuses que les années précédentes. Il y a notamment eu 100 000 manifestant·es à Paris et des milliers à Marseille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Grenoble, Lyon, St Etienne, Lille, Strasbourg…
Pas de fatalité : le combat est possible
Ce succès de la mobilisation2 est un contre-argument à toustes celles et ceux qui disent que le racisme est une tendance dominante dans la société, une vague qui emporte tout, et que la politique des dominants et le discours des médias ne font que refléter l’opinion populaire, répondre à une demande « d’en bas ».
C’est l’opposé qui est principalement vrai. Le racisme est une construction. Ce n’est pas seulement une construction historique, sur le long terme3. Il est aussi une construction conjoncturelle, au travers des politiques racistes de l’État, des discours et faits divers diffusés ad-nauseum dans les médias dominants, des arguments repris de l’extrême droite jusqu’à la gauche contre l’immigration, contre les musulman·es. Ce « racisme d’en haut » a d’autant plus d’influence sur le « racisme d’en bas » qu’il devient légitimé par l’absence de riposte et de contre arguments sans concession.
Le 22 mars vient de montrer que cette construction du racisme n’a pas gangréné toute la société, qu’il est possible de mobiliser massivement contre le racisme et contre le fascisme.
La force du 22 mars est que le thème de la mobilisation était sans ambiguïté : contre le racisme et en solidarité avec les migrant·es mais aussi contre le fascisme (même si ce terme n’apparaissait pas dans un des deux appels).
Mais la possibilité du succès de la mobilisation du 22 mars était déjà présente dans les manifestations qui ont suivi la dissolution de l’Assemblée cet été, à commencer par les 800 000 manifestant·es du 14 juin même si les mots d’ordre de ces manifestations n’étaient pas tournés explicitement contre le racisme et le fascisme. Elle était aussi présente dans le succès de la mobilisation du 8 mars et la volonté d’en chasser les fascistes et les sionistes d’extrême droite.
Aucune organisation de gauche ne peut aujourd’hui se cacher en prétextant que « les gens ne veulent pas se mobiliser contre le racisme ou contre le fascisme ». Le combat est possible : voulez-vous le mener ?
Pas seulement des nombres
Il serait stupide de nier la progression du racisme. C’est d’ailleurs cela qui rend crucial le développement d’une riposte. Le racisme n’est pas l’exclusivité des électeur·ices du RN. Par contre c’est la caractéristique commune des 11 millions qui ont voté RN aux dernières législatives. Le dernier rapport de la CNDH indique que 56 % des sondé·es (chiffres de 2023 en progression de 3 % en un an) pensent « qu’il y a trop d’immigrés en France »4.
Disons d’abord que cela signifie qu’il y a aussi des millions qui ne votent pas pour des partis racistes, ne pensent pas qu’il y a trop d’immigré·es en France. Disons ensuite que ces opinions ne sont pas figées. Au-delà des noyaux durs, les évolutions dans un sens peuvent être renversées dans l’autre. D’autant plus que ces opinions peuvent être très contradictoires. 52 % pensent aussi « qu’il faut que les étrangers aient les mêmes droits que les Français »5.
L’élément déterminant n’est pas tant le débat « rationnel ». Mais l’activité.
Après 2001 et la destruction des tours jumelles à New York, la guerre contre l’Afghanistan puis contre l’Irak fut justifiée par la théorie de « la guerre des civilisations ». Guerre entre l’Occident – blanc et chrétien – censé être libéral et démocratique et l’Orient – arabe et musulman – présenté comme barbare.

Le 15 février 2003 a eu lieu la mobilisation contre la guerre qui, à ce jour, reste la mobilisation record de l’histoire de l’humanité6. Le New York Times déclare « qu’il existe désormais deux superpuissances sur la planète, les Etats-Unis et l’opinion publique mondiale ». Pour des millions, la vision raciste de la guerre de civilisation fut remplacée par celle d’une guerre entre l’impérialisme et les peuples du monde entier.
Il y a donc une différence essentielle de nature entre les millions de voix dans l’isoloir, les sondages au téléphone, les idées exprimées derrière un écran et les centaines de milliers de cet été, du 8 mars et du 22 mars. Les premier·es sont des individus atomisés, fragmentés. Les second sont une force collective susceptible d’agir et de donner à voir une autre réalité que celle présentée par les discours dominants.
Un des aspects qui a permis ce succès a été la décision prise par la France Insoumise mi-février d’en faire une échéance nationale et centrale après la nomination du gouvernement Bayrou. Au travers des interventions systématiques de ses député·es dans les médias, de l’audience de ses réseaux sociaux et aussi de la confiance ainsi donnée à ses soutiens, la participation de la France Insoumise à la mobilisation aux côtés de la Marche des Solidarités a joué un rôle déterminant dans le succès des manifestations.
On doit préciser la signification politique de ce soutien. Après les élections de l’été dernier, la France Insoumise avait participé à diffuser l’illusion institutionnelle (à la fois l’illusion de la possibilité d’un gouvernement « de gauche » et l’illusion de ce gouvernement comme une solution).
La nomination de Bayrou et de son gouvernement et l’échec de la censure, ont mis – temporairement – fin à la possibilité même de l’illusion ouvrant à la décision de faire appel à la rue.
La Marche des Solidarités et les collectifs de sans-papiers ont immédiatement réagi positivement. Ce ne sera pas le cas de toutes les forces impliquées.
Manifestations pas suffisantes : l’alliance avec la CGT
Aussi essentielles soient-elles, les manifestations ne suffisent pas. C’est ce qu’a démontré le mouvement des retraites de 2023.
Au sein de la Marche des Solidarités nous avons toujours argumenté sur l’importance des syndicats. Parce que ce sont les principales organisations de masse. La CGT a 600 000 membres. Mais surtout parce que leur organisation sur les lieux de travail donne un pouvoir que n’a aucun autre front. Imaginez ce qu’une grève des travailleurs et travailleuses dans l’aviation aurait comme pouvoir pour arrêter les expulsions, une grève de l’éducation pour le droit des jeunes mineurs, une grève des travailleurs du bâtiment pour la régularisation de leurs collègues sans-papiers…
En octobre dernier, la CGT a demandé à rencontrer une délégation de la Marche des Solidarités pour proposer de participer à la mobilisation autour du 18 décembre (Journée Internationale des Migrant·es).
La CGT pensait alors que le gouvernement Barnier allait tenir quelque temps avec le soutien, temporaire, du RN. Dans ces conditions il ne pouvait exister la moindre marge de négociation sur le terrain du racisme et de la régularisation des sans-papiers. Y compris pour la CGT.
La CGT a indiqué alors vouloir organiser une vague de grèves pour les papiers au premier trimestre 2025. Cela nécessitait un rapport de force allant au-delà de la CGT ainsi que la nécessité de gagner le soutien d’une partie importante de l’opinion.
Pour la Marche des Solidarités restaient ouverts un certain nombre de débats sur les modalités de cette vague de lutte: Le mouvement de grève devait être ouvert au-delà des structures de la CGT. La discussion devait aussi porter sur l’implication dans la grève des travailleurs et travailleuses « avec » papiers.
Par ailleurs, la porte que pouvait ainsi ouvrir cette vague devait être poussée le plus largement possible. En même temps que les grèves pour la régularisation devaient se lancer d’autres formes de luttes permettant de relayer les revendications des jeunes mineurs isolé·es en lutte, la lutte dans les écoles, contre les centres de rétention, etc…
Mais décision fut prise au sein de la Marche de relever le défi et saisir l’opportunité.
C’est ainsi que fut décidée une coopération active entre la Marche et la CGT dans la mobilisation autour de la journée du 18 décembre puis du 22 mars.
L’unité, moteur ou obstacle ?
L’unité est toujours présentée comme quelque chose de positif à gauche. Il est évident que notre classe étant diverse, l’unité est absolument nécessaire pour gagner. A condition que cette unité soit claire sur ses objectifs et permette l’action commune.
Officiellement, les manifestations du 22 mars ont été appelées par plusieurs cadres regroupant finalement presque tout ce que la gauche peut compter d’organisations syndicales, associatives et politiques.
Cette unité ne permet pas seulement de mettre en mouvement une multiplicité de réseaux et d’individus et de ressources diverses. Elle donne aussi confiance en propageant l’idée que, cette fois, ça pourrait compter.
Des mobilisations du 18 décembre au 22 mars, la Marche des Solidarités a défendu, en permanence, ce qui permettait cette unité la plus large.
Mais plus on avançait vers le 22 mars et plus la CGT et les organisations qui l’entouraient ont cherché à se différencier de l’appel unitaire : en décidant un appel spécifique puis une communication spécifique.
Dès janvier, lors d’une rencontre entre la CGT et la Marche, les représentant·es de la CGT ont commencé à être moins affirmatif·ves sur la perspective d’une vague de luttes.
La portée de cette différenciation est devenue claire quand la France Insoumise a décidé, mi-février, de s’impliquer dans la mobilisation pour le 22 mars.
Dès lors la CGT et la LDH, soutenues par des organisations comme SOS-Racisme ont, de fait, abandonné clairement tout effort pour mobiliser pour le 22 mars justifiant leur attentisme par la nécessité de clarifier les rapports avec la France Insoumise. D’abord prétextant les volontés hégémoniques de la FI. Puis, utilisant la polémique autour de l’affiche contre Hanouna pour la dénoncer et refuser toute mobilisation commune.
Il faut donc le dire : officiellement la mobilisation est apparue comme regroupant un large spectre d’organisations. Elle a pu être vécue de cette manière dans de nombreux milieux et structures locales des organisations, donnant la confiance de se mobiliser, de prendre des initiatives de convergence, etc.
Dans la réalité un certain nombre de forces (je parle là des directions nationales, celles notamment de la CGT et de la LDH) n’ont construit que marginalement la mobilisation concrète7. Par certains aspects, elles ont mis des obstacles à cette mobilisation.
Cela ne nous amène pas à remettre en question la nécessité de l’unité et de l’implication des syndicats. Au contraire, nous en déduisons que la mobilisation aurait pu être encore plus puissante. Et que nous devons comprendre ce qui s’est joué pour pouvoir le dépasser.
Pourquoi ce changement de la CGT ?
La chute du gouvernement Barnier et les conditions de nomination du gouvernement Bayrou ont mis en lumière deux stratégies différentes à gauche qui ont des conséquences immédiates sur la lutte contre le racisme et en solidarité avec les migrants.
La France Insoumise en a conclu qu’il n’y avait plus – temporairement – de débouché institutionnel. Et que la politique de Macron et Bayrou ouvrait directement la voie au RN. La France Insoumise en a déduit qu’une alternative de gauche ne pouvait se construire (y compris électoralement) que sur la base d’une polarisation claire contre le racisme.
Pour la direction de la CGT, convergeant avec la LDH, SOS-Racisme… et le PS ou le PCF, la chute du gouvernement Barnier, par le Rassemblement National, a réactivé la politique du moindre mal qui était présente derrière les appels au vote pour Macron lors des dernières présidentielles ou les appels à voter pour les candidats de droite au second tour des législatives de cet été. Ces candidats, comme Darmanin, élus avec les voix de la gauche… pour faire aujourd’hui la politique du RN. Dans cette perspective, garantir la possibilité d’un nouveau front républicain avec une partie de la droite contre le RN, exige de mettre la pédale douce sur une possible polarisation anti-raciste et antifasciste.
Quelles suites/pistes
- Tout, dans la politique de Retailleau, confirme qu’il n’y a pas de marge de négociation avec ce pouvoir. Que le seul langage qu’il peut entendre, la seule possibilité d’obtenir le moindre résultat, repose sur la confrontation et le rapport de forces.
- Il est évident que le recul de la direction de la CGT a changé les possibilités ouvertes dans l’immédiat d’une lutte frontale contre le pouvoir. Sa position pourrait à nouveau changer. Mais nous ne devons pas attendre et en dépendre. Il faut que des syndicalistes s’engagent, argumentent pour entraîner leurs sections, se coordonnent dès maintenant.
- Nous devons favoriser le développement d’organisations locales liées à la Marche des Solidarités, ville après ville, quartier après quartier, collectifs de sans-papiers, collectifs de quartiers. C’est notamment essentiel pour riposter contre les tentatives d’expulsion, pour défendre les mosquées, pour empêcher les fascistes de s’implanter…
- La coopération entre la France Insoumise et la Marche des Solidarités ne s’est pas arrêtée au 22 mars. Elle s’est poursuivie de manière positive dans la riposte à la tentative du RN de mobiliser ses troupes dans la rue le 6 avril en réaction à la condamnation de Marine Le Pen. Elle s’est aussi poursuivie dans la préparation des manifestations contre l’islamophobie du 11 mai. Cette coopération doit continuer tout en ouvrant aussi des débats.
- Si un mouvement d’ensemble, une vague de luttes n’est pas immédiatement possible, cela ne signifie pas que nous devons nous contenter de développer nos organisations. Des initiatives doivent être prises pour cristalliser, y compris de manière partielle et limitée, la confrontation avec le pouvoir et obtenir des résultats concrets.
Denis Godard (Paris 20)
- Il est important de spécifier d’où je parle. Je parle ici en tant que membre d’A2C sur la base de l’expérience de ma participation dans la mobilisation avec la Marche des Solidarités ↩︎
- Bien sûr ce succès est relatif si on considère les enjeux. Certains le relativisent. De manière intéressante quand nous n’étions que quelques milliers les autres années… ils et elles n’éprouvaient pas le besoin d’en parler ! ↩︎
- Le racisme a, dès l’origine, été construit pour justifier l’esclavage puis le colonialisme lors du développement du capitalisme. C’est, historiquement, qu’il est devenu structurel. ↩︎
- Commission nationale consultative des droits de l’homme. Voir sur le site de la CNCDH (cncdh.fr) ↩︎
- La contradiction persiste avec le chiffre précédent même si ce chiffre est, lui, en recul de 5% en un an (exprimant ainsi une dynamique qui va dans le même sens). ↩︎
- Avec des manifestations de masse sur tous les continents : https://lanticapitaliste.org/opinions/histoire/15-fevrier-2003-la-plus-grande-manifestation-de-lhistoire ↩︎
- Cela s’est traduit d’ailleurs par la taille de certains cortèges dans la manifestation parisienne : celui de la CGT – limité aux sans-papiers – étant même plus faible que le 14 décembre. ↩︎