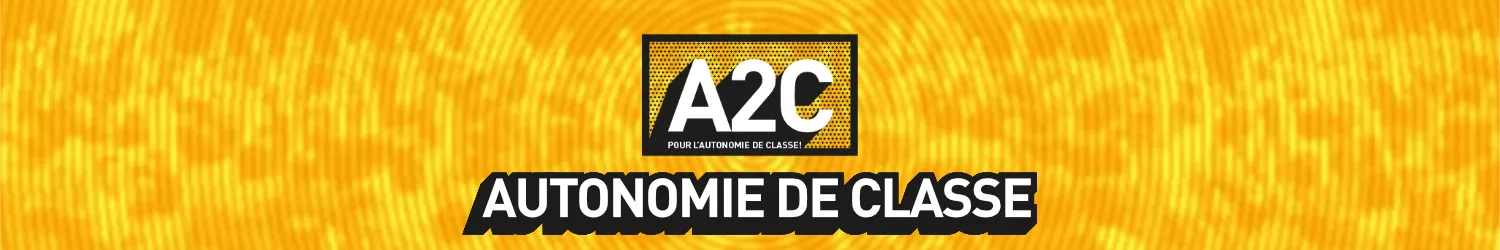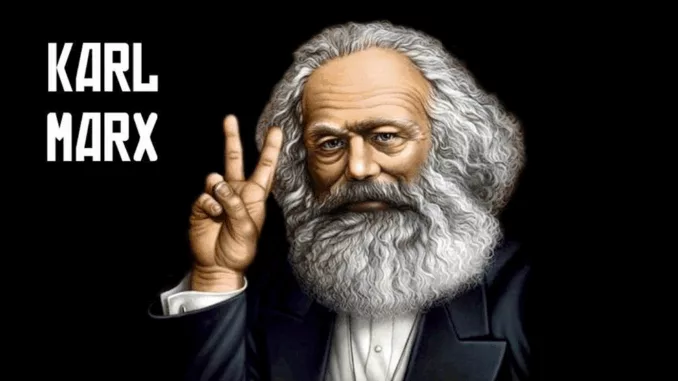
« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes. (…) Oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société toute entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. »
Voilà comment commence le Manifeste du parti communiste de Marx.
Si l’on définit par marxisme toutes les expériences, luttes et analyses développées sur la base des écrits de Marx, alors le marxisme est la théorie de la lutte contre le capitalisme, la théorie de la révolution.
Révolutionnaire
Les idéologues dominants ne nient pas qu’il existe une histoire. Mais cette histoire s’arrête au capitalisme qui, quels que soient ses défauts, serait l’organisation sociale « naturelle », celle qui correspondrait le mieux à ce qui serait la « nature humaine ».
Pour Marx, le capitalisme, en tant que société de classes, peut et doit être dépassé.
L’histoire est faite par les êtres humains sur la base de leurs intérêts matériels et non par de grands principes, le progrès, la raison, la civilisation…
A rebours des livres qui résument l’histoire à celle des grands hommes, rois, reines, intellectuels, présidents, etc., l’histoire selon Marx est faite par les grandes masses.
Le marxisme est la théorie qui montre que la révolution est non seulement nécessaire mais surtout qu’elle est possible.
Bases matérielles
C’est la simplicité évidente du point de départ de Marx qui est subversive : toute société humaine s’explique d’abord par la manière dont les êtres humains s’organisent pour produire ce dont ils et elles ont besoin. Cette organisation est fonction des conditions naturelles et des connaissances et moyens disponibles pour en utiliser les ressources (moyens de production et formes de coopération, ce que Marx a appelé forces productives).
Il a fallu des milliers d’années à l’humanité pour développer des connaissances, des techniques et des formes d’organisation capables de dépasser la production de moyens de survie immédiate (cueillette, chasse…).
Il y a 10 000 ans, de nouvelles formes de subsistance (culture, élevage) permirent la production d’un surplus. L’existence matérielle de ce surplus a entraîné le développement d’une couche sociale, détachée de la production directe, vouée à la « gouvernance » de ce surplus et en vivant.
Il fallut encore des milliers d’années pour que cela provoque une réorganisation profonde des rapports sociaux et une division de la société en classes aux intérêts antagonistes.
La minorité vivant du travail de la majorité s’est mise à identifier ses intérêts propres, l’extraction d’une part plus importante des produits du travail, avec l’intérêt général. Marx appelle cette extraction du surplus, l’exploitation.
Commence alors cette phase décrite par le Manifeste où l’histoire devient l’histoire des luttes de classes.
Lutte de classe, histoire et révolution
Un philosophe allemand, Hegel avait écrit que la contradiction est « à la racine de tout mouvement et de toute vie », la seule réalité est le changement, le mouvement.
Pour Marx le mouvement de l’histoire est le produit des contradictions de classe qui mènent au conflit permanent, « tantôt ouvert, tantôt caché » entre la minorité vivant du surtravail et les producteurs et productrices.
Et, « à un certain niveau de leur développement, les forces productives [découvertes technologiques, « amélioration » de l’organisation du travail…- DG] entrent en conflit avec les rapports de production existants [la division en classe correspondant – DG]. (…) De formes de développement des forces productives, ces rapports en deviennent des entraves. »
Le capitalisme est un exemple extrême de ce développement. La pression à l’accumulation du capital, la division du travail ont permis un développement prodigieux de la production et des techniques. Mais ce sont aujourd’hui les mêmes impératifs du capital qui font que la surproduction côtoie la famine ou que des moyens considérables de contrôle, de surveillance et de répression sont développés pour empêcher des millions d’êtres humains d’utiliser les prodiges technologiques permettant de se déplacer sur toute la planète…
C’est alors, dit Marx, que la société entre dans des crises profondes, économiques, sociales et politiques, situations qui ne peuvent être résolues positivement que par la transformation révolutionnaire de la société c’est-à-dire le renversement de l’organisation sociale existante et de la classe sociale qui en bénéficie et la défend.
Lutte politique
L’organisation sociale ne se réduit pas aux rapports de production. Marx explique comment se construit, sur cette base, tout un édifice social, politique, militaire, idéologique « à quoi répondent des formes déterminées de la conscience ». Édifice dont l’institution centrale est l’État et qui assure la reproduction du système.
Il s’ensuit que la lutte de classe n’est pas une lutte limitée aux rapports de production. Elle prend la forme de luttes idéologiques, politiques, de luttes contre l’État…
A celles et ceux qui – déjà ! – réduisaient le marxisme à l’économisme, le compagnon de Marx, Engels expliquait : « D’après la conception matérialiste de l’histoire, le facteur déterminant est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx ni moi n’avons jamais affirmé davantage. Si quelqu’un dénature cette position en ce sens que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme ainsi en une phrase vide, abstraite, absurde. »
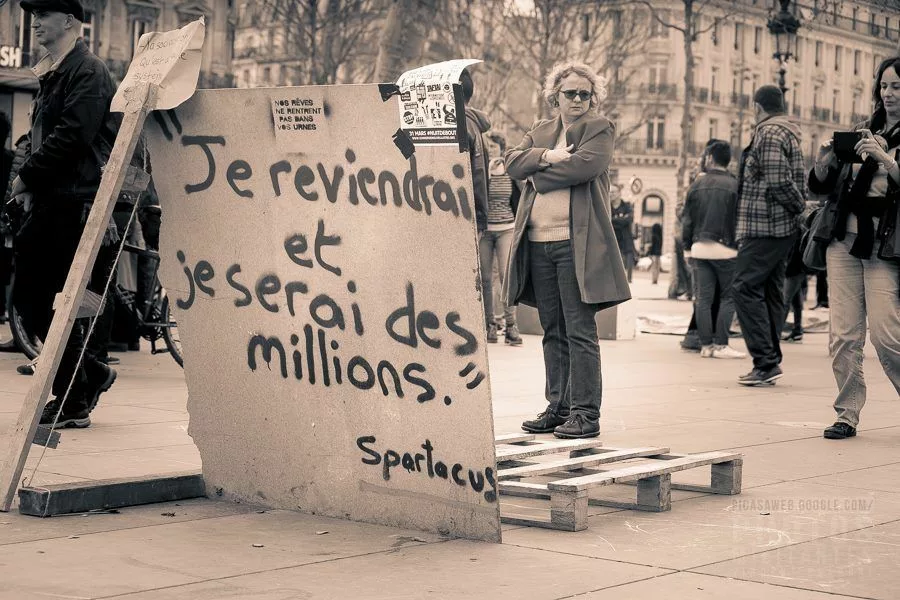
La folie du capitalisme
Dans tous les systèmes qui ont précédé le capitalisme le travail était destiné à la consommation, fût-elle celle des exploiteurs. Marx explique ainsi que sous le féodalisme l’exploitation était limitée par « les parois de l’estomac du seigneur » (entretien de la cour, levée d’une armée…).
Mais une fois que les « besoins » étaient couverts, il n’y avait pas de pression pour produire davantage.
Sous le capitalisme, le profit n’est pas orienté essentiellement vers la consommation – soit-elle celle des capitalistes. Il est évident que Bernard Arnault ou Elon Musk ne vivent pas du tout comme nous. Il n’en reste pas moins que l’essentiel des profits de leurs entreprises est dirigé vers l’investissement ou les marchés financiers dans le but de créer plus de profit. Marx nomme ce processus l’accumulation du capital.
Augmenter constamment les profits pour pouvoir les réinvestir dans de nouveaux moyens de production, de nouvelles technologies et machines est indispensable pour augmenter la productivité et assurer la compétitivité vis-à-vis des capitalistes concurrents.
D’où le cycle infernal de la pression à l’accumulation, à l’augmentation permanente du taux d’exploitation.
« Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d’ordre de l’économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise ».
Bases pour un autre système
L’accumulation sans limites explique le dynamisme du capitalisme. C’est le premier système dans l’histoire de l’humanité à avoir tellement développé les richesses, ou la capacité à les produire, qu’il n’existe aucune raison à la misère, à la faim, à la pauvreté. Pendant des milliers d’années des êtres humains sont morts parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture. Sous le capitalisme des gens meurent de faim parce qu’il y a trop de nourriture.
Il existe aujourd’hui les bases matérielles pour une organisation sociale qui ne soit plus déterminée par la lutte pour la survie, pour passer « du règne de la nécessité à celui de la liberté », ce qu’on peut appeler le communisme.
Le capitalisme a développé une autre base pour une société sans classe. La classe ouvrière est en effet la première classe exploitée de l’histoire de l’humanité à avoir été totalement dépossédée des moyens de production. Les prolétaires sont celles et ceux qui ne possèdent que leur force de travail.
C’est ce qui fait, pour Marx, de la classe ouvrière la classe potentiellement universelle. Car la prise de pouvoir des travailleurs et travailleuses signifie l’organisation de la production – et donc de toute la société – sur une base collective et la disparition des classes sociales.
Système en crise
Les mêmes raisons qui expliquent le dynamisme du capitalisme le poussent vers des crises non seulement régulières mais aussi de plus en plus profondes.
La production capitaliste combine la planification de la production avec l’anarchie du marché. Il faut une division du travail très poussée et une planification très précise pour la production et l’assemblage d’un ordinateur, d’une voiture ou d’un téléphone. Par contre la concurrence règne entre différents groupes et il n’y a pas de planification entre différentes branches, entre la production et le marché du travail, l’approvisionnement en matière première ou l’apport de capitaux. Ce qui fait que la chaîne globale du capitalisme entre dans des crises régulières.
Mais s’ajoute à cela le fait que ces crises sont de plus en plus profondes. L’accumulation du capital, poussée par la concurrence entre capitaux, amène les capitalistes à investir de plus en plus dans de nouvelles technologies et de nouvelles machines pour augmenter la productivité. Cette augmentation de la part relative des machines dans le capital, au détriment de la force du travail, provoque ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Cette baisse des taux de profits est à la base des crises de plus en plus profondes qui ébranlent tout le système politique.
Cette double dynamique du capitalisme a amené Engels et la révolutionnaire polonaise Rosa Luxemburg à parler de l’alternative, socialisme ou barbarie. La barbarie porte aujourd’hui les noms de génocide, guerre, fascisme et catastrophe environnementale.
L’émancipation
Le mot d’ordre sans doute le plus connu de Marx est « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » qu’il nous faut impérativement féminiser.
Condensé de toute l’analyse de Marx c’est aussi une boussole pour déterminer ou juger toute stratégie révolutionnaire.
D’abord il n’y a pas de fatalisme chez Marx. Son analyse de l’histoire et du capitalisme ne détermine aucun but : socialisme ou barbarie. Les êtres humains ne choisissent pas les conditions dans lesquelles ils et elles font l’histoire. C’est bien pour cela qu’il faut s’efforcer de connaître et comprendre au mieux ces conditions. Mais ce sont eux et elles qui font l’histoire : l’issue de la lutte de classe ne peut être déterminée que par les classes elles-mêmes, leur niveau de conscience, d’organisation, de détermination.
Ensuite la classe ouvrière ne peut obtenir son émancipation de l’extérieur : l’émancipation des travailleurs et des travailleuses ne sera pas l’œuvre d’une minorité, d’un parti, d’un bon gouvernement ou d’un État, elle sera l’œuvre de dizaines de millions, de centaines de millions de travailleurs et de travailleuses. Marx a écrit que la révolution n’était pas seulement nécessaire pour changer les structures sociales et politiques. « Elle l’est également parce que seule une révolution permettra à la classe qui renverse l’autre de balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société sur des bases nouvelles. »
Denis Godard (Paris 20)
Recommandations de lecture sur le sujet
Pour commencer avec Marx (sur marxists.org) :
- Le Manifeste du parti communiste (https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000.htm)
- Travail salarié et Capital (https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/12/km18471230-4.htm)
- Salaires, prix et profits (https://www.marxists.org/francais/marx/works/1865/06/km18650626.htm)
Une bonne introduction des idées de Marx :
Alex Callinicos, Les idées révolutionnaires de Karl Marx, éditions Syllepse.
Un livre magistral sur l’histoire :
Chris Harman, Une histoire populaire de l’humanité, éditions La Découverte.
Recommandation audio sur le sujet :