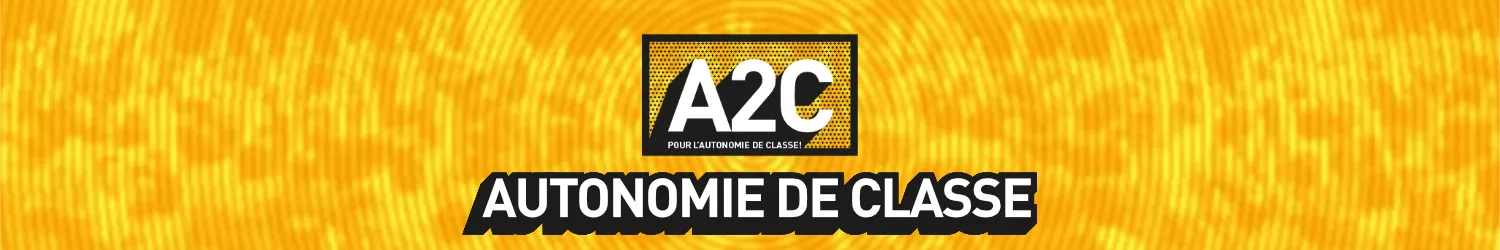(traduit de l’Arabe, première publication lundi 29 septembre 20251)
Samedi 27 septembre, vers cinq heures de l’après-midi, le jardin de l’Université de Casablanca accueillait de nouveaux visiteurs. Ce n’étaient pas les enfants qui ont pour habitude de venir avec leurs familles échapper à la pollution et au chaos de la ville. Ce jour-là, le jardin s’est trouvé quadrillé par les membres de la police anti-émeute accompagnés de centaines de mouchards des différents services de renseignement, de canons à eaux et d’autres installations destinées à la répression.
Toutes ces forces furent mobilisées pour accueillir des manifestant.e.s qui s’étaient organisé.e.s sur des réseaux sociaux comme Discord, en-dehors des cadres traditionnels de mobilisation que nous connaissons au Maroc. Leur revendications ? Santé et éducation, deux secteurs sacrifiés par les politiques publiques qui les ont dégradé pour mieux les offrir aux promoteurs du secteur privé. La colère mène la jeunesse à prendre la rue : l’État construit des stades grandioses pour la Coupe du Monde (NdT : de football en 2030) alors que les écoles et les hôpitaux sont délabrés. Pour la génération Z, ce fut la goutte qui a fait déborder le vase : “la santé d’abord, on ne veut pas de la coupe du monde”.
Les organisateur.ice.s des manifestations insistent sur le caractère non-politique de leur mouvement, et semblaient certain.e.s, avant les manifestations, que l’État traiterait le mouvement avec un paternalisme presque bienveillant, tant leurs revendications sociales étaient légitimes. “Ils disent que la constitution garantit la liberté de manifester”, affirmait l’un d’eux sur Discord. L’État a travaillé d’arrache-pied pour couper la génération Z des expériences de luttes politiques et sociales menées par les générations précédentes. C’est peut-être de là qu’est venue la surprise : les manifestations de samedi et dimanche (NdT : les 27 et 28 septembre), qui ont été violemment réprimées et au cours desquelles des centaines de jeunes furent arrêté.e.s et inculpé.e.s de tous les crimes imaginables, ces manifestations n’étaient absolument pas attendues par les différents services marocains de sécurité et de répression. Les mouvements du 20 février (2011) et du Rif (2016-2017) ont été contenus et réprimés avec une telle sévérité que l’Etat en a tiré la conviction profonde que ces expériences ne se répéteraient pas. Mais c’était sans compter sur la dégradation des conditions de vie de la majorité, en particulier celles de la génération Z qui subit un taux de chômage de 48% selon les derniers chiffres de la Banque du Maroc.
Vers un printemps marocain sans les erreurs du printemps arabe ?
Le printemps arabe s’était déclenché en Tunisie avec l’auto-immolation du martyr Mohammed Bouazizi en protestation contre la hagra policière. L’étincelle qui a mis le feu aux poudres au Maroc fut la mort de huit femmes enceintes à la maternité de l’hôpital public d’Agadir. Cet incident tragique a immédiatement suscité des manifestations spontanées dans la ville, mais c’est l’arrogance de l’État et de ses représentants qui a tout fait basculer. Cet État s’est habitué à infliger humiliation après humiliation à ses citoyen.ne.s, avant tout l’humiliation de la “normalisation” des relations avec l’État d’Israël contre la volonté de l’immense majorité de la population, mais aussi la priorité manifeste donnée à la construction des stades pour la Coupe du Monde alors que la majorité des victimes du séisme de 2023, qui a touché les zones les plus pauvres qui ne verront rien de la Coupe du Monde, n’ont pas été relogées. Pour couronner le tout, il y cette phrase du ministre de la santé venu visiter l’hôpital d’Agadir après la mort des femmes : “Que ceux qui ont un problème viennent me voir dans la capitale”. Rabat, la capitale du Maroc, se trouve à 600 kilomètres d’Agadir.
La répression subie par la jeunesse lors des manifestations du week-end n’a pas eu l’effet escompté par les autorités, bien au contraire. Une des premières décisions prises lors des AG virtuelles (qui comptaient jusqu’à 1500 participant.e.s) a été, contrairement au mouvement du 20 février qui manifestait une fois par semaine en 2011, de prendre la rue tous les jours. Ce qui s’exprime dans ce mouvement va au-delà d’une liste de revendications, il dénonce au grand jour un État incapable d’adresser les demandes les plus minimalistes, les plus raisonnables, ce qui veut dire que ses promesses ne sont que des mensonges. Ces jeunes qui se disent non-politiques incarnent en réalité la pratique politique la plus élevée du pays.
Le Maroc accueille la Coupe d’Afrique des Nations dans deux mois. Les autorités sont engagées dans une course contre la montre pour éteindre une colère qu’ils ont eux-mêmes allumée et attisée. Les arrestations de masses ont elles aussi aggravé la crise, et l’État ne semble pas avoir d’autre solution que la répression face à une jeunesse qui sent qu’elle n’a plus rien à perdre. Les expressions sur les visages des jeunes hommes et des jeunes femmes emmené.e.s au commissariat en disaient long sur leur état d’esprit : pas de peur mais beaucoup de courage et de fierté, une manière de dire à leurs tortionnaires : “vous ne nous impressionnez plus, et je sais que si vous m’arrêtez, des centaines d’autres viendront après moi”.
Les médias mainstreams ont reçu pour directive de ne pas transmettre d’informations, et les journaux de préfecture ont accusé les jeunes de trahison envers la patrie. Mais ces mêmes jeunes ont suscité l’admiration des milieux culturels et artistiques, notamment des rappeurs.
Les fautes fatales de l’État
Face à un mouvement qui se voulait de prime abord non radical et qui annonçait clairement ne pas viser la chute du régime, l’État a fait le choix de la répression plutôt que du paternalisme habituel. La jeune génération en a tiré des enseignements, qui sont certes toujours en cours de fermentation, mais qui les mènent déjà à penser que les problèmes ne sont pas sectoriels et que les solutions ne seront ni superficielles ni techniques. Les problèmes sont structurels et profondément liés à la démocratie, la seule solution est la participation de toutes les catégories du peuple aux décisions politiques pour que ces dernières répondent aux besoins essentiels du peuple.
Les accusations de déstabilisation du pays et les injonctions à se contenter de voter aux élections fonctionnaient peut-être par le passé mais ne convainquent pas la génération actuelle. Il ne reste plus aux autorités marocaines la moindre forme de médiation avec la société pour régler une crise aussi profonde, mise à part l’application pure et simple des revendications populaire.
Les jours à venir nous en diront beaucoup sur les suites de la lutte, mais il est important de comprendre que le pays vit actuellement une véritable crise qui déséquilibre le pouvoir, c’est-à-dire la monarchie. La génération Z utilise le sarcasme sans modération pour mobiliser. Lorsqu’un jeune demanda “où est le Roi, pourquoi ne répond-il pas aux manifestations de samedi et dimanche ?”, son camarade lui rétorqua : “le Roi ne travaille pas le week-end”.
Yehya Cheikh el Arab
- https://revsoc.me/arab-and-international/50470/ ↩︎