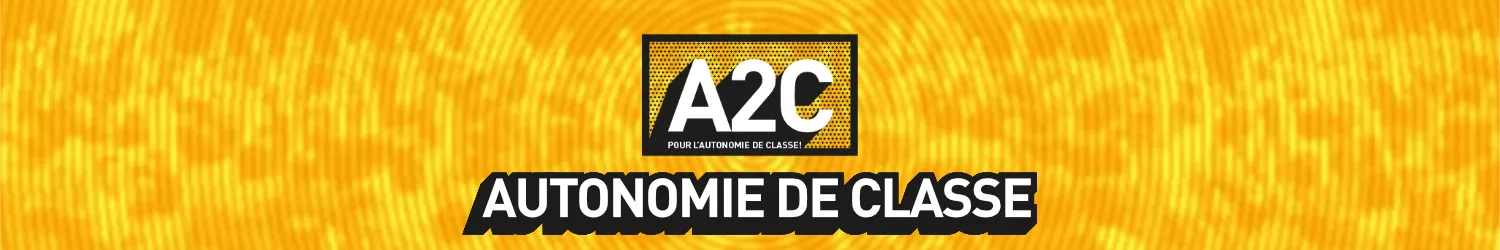La conscience de classe est le plus souvent présentée comme une chose binaire : on l’a ou on ne l’a pas. La réalité est beaucoup plus complexe et heureusement, beaucoup plus dynamique. Alors, comment une « classe en soi », objectivement constituée par l’exploitation collective qu’elle subit, peut-elle devenir une « classe pour soi », prenant conscience de son intérêt commun et de son pouvoir transformateur ?
Les Cahiers d’A2C #17 – juin 2025
Cet article ne prétend pas offrir de réponse toute faite à cette question qui taraude tout.e révolutionnaire ; il vise néanmoins à montrer que dans l’expérience d’une grève, somme toute assez banale, on trouve les débuts d’un processus de transformation.
Avant de passer à l’action, il est nécessaire de planter le décor de cette lutte. Nous parlons d’un site de l’industrie aéronautique en région parisienne employant un petit millier de personnes, réparties entre usine et bureaux d’études. Un peu plus de la moitié des salarié.e.s sont ouvrièr.e.s et technicien.ne.s et les autres sont des cadres (ingénieur.e.s, managers, etc). 90% de la production est pour le marché civil, le reste pour l’armement.
La « cadrisation » est une tendance généralisée dans la haute technologie : il faut de plus en plus d’ingénieur.e.s pour produire. Malgré leurs salaires un peu plus élevés que les non-cadres, iels subissent des conditions dégradées et ce sont des travailleur.e.s exploité.e.s au même titre que les autres.
Par contre, une minorité des cadres organise la production et discipline la main d’oeuvre pour le compte de la bourgeoisie : elle ne fait donc pas partie de notre classe.
Diviser les cadres pour unir la classe
Traditionnellement, la CGT organise surtout les ouvrièr.e.s et technicien.ne.s, qui constituent le gros des effectifs des grévistes dans l’aéronautique.
La plupart des jeunes ingénieur.e.s viennent de milieux confortables mais se rendent compte que leurs conditions de travail et de vie seront moins favorables que leurs parents, et peuvent être influencé.e.s par les mouvements féministes, antiracistes et écolo de ces dernières années.
La CGT locale perçoit la nouvelle réalité. Sans faire de compromis sur les principes, il faut faire preuve de pédagogie en s’adressant à ces travailleur.e.s qui ne connaissent pas les codes traditionnels du mouvement ouvrier.
Alors on appuie systématiquement sur ce qui peut unir les cadres exploité.e.s aux non-cadres, pour faire comprendre aux deux catégories qu’elles appartiennent à la même classe. Le travail finit par payer : de plus en plus de jeunes ingénieur.e.s débrayent pour la première fois avec les ouvrièr.e.s et technicien.ne.s. Ce sont des grèves courtes mais actives : on se lève du bureau ou de l’atelier et on va au rassemblement, avec pourquoi pas un petit tour du site pour faire débrayer plus de collègues. On choisit son camp, on s’affiche devant ses collègues et son patron. Le quart des effectifs participe activement au mouvement.
La CFE-CGC, syndicat des cadres, est marginalisée : c’est contre ses deux piliers – l’unité entre tous les cadres, des ingés au top managers, et la docilité envers la direction – que se mobilise une partie des cadres.
La CGT bronche au moment d’escalader
Les négociations avec la direction s’enlisent mais le mouvement continue de grandir : une escalade s’impose, elle est possible. Il faut passer à la grève reconductible avec piquet. Mais c’est là que les militant.e.s CGT se mettent à douter : ok, les « ingés » nous ont suivi sur les débrayages, mais sur une grève ouverte ? Ok, les « gars de l’usine » nous poussent à bloquer le site, mais on les connaît, ce sont des grandes gueules.
C’est ainsi que la CGT, qui était la locomotive du mouvement, finit par le laisser s’arrêter. La défaite a un goût amer car les possibilités ouvertes par la lutte n’ont pas été exploitées.
Que reste-t-il de ce rendez-vous manqué ?
Les moments de débrayage sont précieux : on est content.e.s de se retrouver et des discussions s’engagent entre collègues qui ne se connaissent pas.
On ressent aussi le besoin de généraliser, des discours militants contre le racisme et l’extrême-droite sont très bien reçus. Les jeunes travailleuses qui débrayent pour la première fois n’hésitent pas à dénoncer les slogans à connotation sexiste.
Il faut le vivre pour comprendre : après le débrayage, le discours des collègues change. On passe de moi à nous, on échange des idées farfelues, on s’approprie la question principale : comment gagner ? Pendant quelques jours, une euphorie nous colle à la peau.
Les discours et la propagande jouent un rôle indéniable, mais seulement comme précurseurs à l’action. Car c’est dans la lutte qu’on a l’ouverture vers la conscience de classe. Comment se donner les moyens, collectivement, de décider de ce qu’on produit et à quel.le.s fins, dans un secteur où production civile et militaire coexistent ?
C’est bien la question centrale qui doit nous faire passer de salarié.e.s aliéné.e.s de nos collègues et du produit de notre travail, à producteur.e.s conscient.e.s de notre place dans la société. Dans un contexte de tensions impérialistes, quand les classes dirigeantes menacent d’entraîner l’humanité dans de nouvelles guerres, l’enjeu n’est pas d’améliorer les conditions dans lesquelles les travailleur.e.s produisent des armes, mais d’utiliser notre pouvoir pour décider de ce que nous produisons, pour conjurer la catastrophe annoncée.
En ouvrant la discussion avec les travailleur.e.s sur l’arrêt de la fourniture d’armes à Israël, voire la réorientation de la production vers des applications civiles, des syndicats de l’armement (Thales, STMicroelectronics, Airbus Defense) font des premiers pas dans la bonne direction. Il est urgent de généraliser ces expériences et de les approfondir en utilisant le levier de la grève qui ouvrirait de nouvelles perspectives.
Il s’agit donc d’avoir des discussions politiques dans les syndicats et avec les syndicats. De mettre l’accent sur l’aspect transformateur de la lutte. De comprendre que celleux qui ont goûté à leur premier débrayage ne sont plus les mêmes. Et qu’iels pourraient bien vouloir aller plus loin…