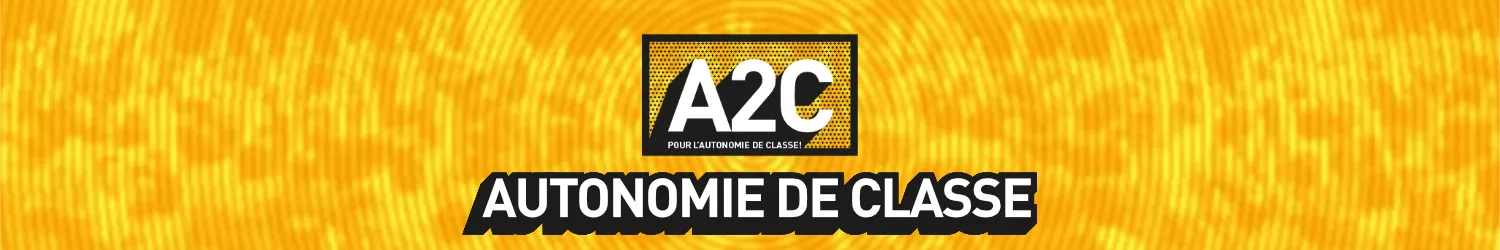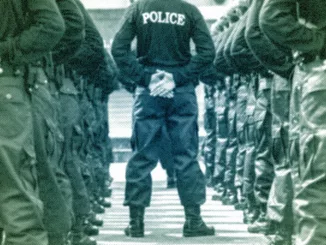« lorsque les fascistes reviendront, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon », prédisait Orwell après la défaite des fascismes historiques.
Les Cahiers d’A2C #17 – JUIN 2025
En 1945, le fascisme est tellement marqué du sceau de l’infamie que ceux qui s’en réclament toujours ont dû renouveler à la fois leur look et leurs méthodes pour sortir de la marginalité politique. La chemise blanche a remplacé la chemise brune. Plus de crânes rasés, ni de croix gammées. Le FN est pensé dès le départ comme une tentative de dédiabolisation. Fondé par des anciens nazis, collabos et membres de l’OAS1, il ne fait aucun doute que le FN porte un projet fasciste. Mais comme de nombreux mouvements similaires en Europe, il a opté pour la stratégie électorale, conscient, comme le disait un de ses idéologues, que si la flamme fasciste devait brûler à nouveau « elle ne pourrait brûler de la même manière parce que l’atmosphère a été profondément modifiée ».
Ce changement d’habits et de méthodes a berné une bonne partie de notre camp qui s’arrête à ce constat : contrairement aux fascismes historiques, le RN d’aujourd’hui n’est pas un mouvement de masse (bien qu’il revendique 100 000 adhérents) et ne dispose pas d’une milice. Beaucoup de militant.es en concluent que le RN ne serait donc pas fasciste mais simplement d’extrême-droite, c’est-à-dire plus raciste et autoritaire que les autres. Une différence de degrés, donc, et non de nature. C’est un problème qui pourrait nous coûter cher car si on attend que le RN ait constitué un mouvement de masse pour le qualifier de fasciste et le combattre comme tel, il sera trop tard pour avoir raison.
Un détour par l’histoire et les écrits de Gramsci permet de comprendre que si le RN ne dispose pas de chemises noires, brunes ou bleues marine aujourd’hui, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il n’en aura pas demain. L’histoire du FN/RN comme celle de tous les partis fascistes est, en effet, marquée par des allers-retours entre recherche de respectabilité et radicalité. Ces partis oscillent entre l’un et l’autre en fonction des rapports de force internes, de leur stade de développement et d’éléments extérieurs (puissance du mouvement ouvrier, contexte économique et politique).
Les deux fascismes
L’idée d’une tension stratégique entre la matraque et la cravate est exposée dès 1921 dans un article de Gramsci intitulé Les deux fascismes. A l’époque, il explique que cette tension se cristallisait autour de deux pôles – le fascisme agraire incarné par les propriétaires terriens et le fascisme urbain porté par les petits-bourgeois des villes (petits commerçants et anciens combattants) – qui ont des motivations et des intérêts matériels différents mais qui sont réunis par l’anti-socialisme et la mise en mouvement radicale proposée par Mussolini. Gramsci raconte que la violence fasciste (expéditions punitives contre des villes socialistes menées par des armées de centaines voire milliers de chemises noires) finit par créer une retenue chez les petits bourgeois des villes. Ces derniers considèrent alors que la violence était utile au début pour neutraliser les socialistes2 mais qu’elle risque désormais de gêner leur alliances électorales et de mécontenter les couches moyennes. Les fascistes ruraux, eux, ne veulent pas renoncer à la violence car ils en ont besoin pour surexploiter la paysannerie et mater ses révoltes3.
Gramsci prédit que cette tension pourrait être génératrice de scission au sein du camp fasciste et qu’elle pourrait entraîner la création d’un parti qui porterait les idées fascistes sur le terrain parlementaire mais qu’elle ne fera pas cesser les violences du « fascisme véritable » dans la rue. Mussolini, par exemple, s’est engagé sur le terrain parlementaire tout en encourageant en sous-main le développement de milices violentes sur lesquelles il s’est appuyé pour arriver au pouvoir.
Globalement, le succès des fascismes italiens mais aussi allemands tient au fait que leurs dirigeants ont su faire tenir ensemble la matraque et la cravate en trouvant le bon dosage au bon moment.
En 1930 et en 1931, alors que le parti nazi, le NSDAP, s’est énormément développé, Hitler doit faire face à une autre crise. Les SA (chemises brunes), qui étaient déjà très puissantes (170 000 hommes en 1931) mais mal payées et impatientes de prendre le pouvoir, ont protesté contre les tentatives d’Hitler de gagner en respectabilité, notamment quand ce dernier a temporairement interdit les violences de rue. Elles ont alors occupé par deux fois le siège du parti nazi. Hitler s’en est sorti grâce à la diplomatie et à la purge de 500 d’entre eux, les plus radicaux.
Ensuite, en juillet 1932, le NSDAP devient le 1er parti d’Allemagne. Hitler refuse la proposition du Président de devenir vice-chancelier. Il joue la carte du tout ou rien (comme Bardella en 2024). Il doit faire face à de vives tensions internes. De nombreux cadres du parti sont, en effet, tentés d’accepter les propositions de coalition faites par les conservateurs. Ces tensions s’accentuent avec la contre-performance électorale de novembre 1932. Le NSDAP est alors en crise. Il n’a plus d’argent. Il reste 1er parti d’Allemagne mais a perdu son élan alors, qu’à l’inverse, le KPD (parti communiste allemand) progresse. Le parti nazi est désormais au bord de l’implosion. Il est sauvé finalement par une partie des conservateurs qui nomment Hitler chancelier en pensant pouvoir le contrôler et damer le pion à des conservateurs concurrents.
Fascisme en tension au sein du FN
Le FN/RN n’a pas non plus échappé à ces tensions. Depuis sa création, il marche sur une instable ligne de crête. Pour se développer, les dirigeants du FN cherchent à dissimuler les liens qui les unissent aux militants violents et à créer des ponts idéologiques et politiques avec la droite conservatrice. Mais plus ils se rapprochent du pouvoir, plus ils courent le risque de se ramollir et d’être dilués dans la droite conservatrice. Pour éviter cette dérive à gauche et la notabilisation du parti (le fait que ses élus soient prêts à renier leur projet politique pour garder leur place au chaud), le FN fait parfois le choix de la radicalité. C’est ce qui s’est passé dans les années 1980. Après les premières victoires électorales du FN, Jean-Marie Le Pen a choisi de durcir sa ligne en multipliant les « dérapages » racistes et homophobes qui étaient, en fait, tout à fait contrôlés. Le pari était que cela ferait peut-être fuir quelques personnes mais que cela ressouderait les troupes derrière le chef. Il prédisait aussi que les voix perdues seraient regagnées par la suite et de manière plus durable. Le pari s’est avéré gagnant. Le FN a réussi à fidéliser un électorat grossissant sur des bases ouvertement réactionnaires.
Cette radicalisation a aussi permis de donner des gages aux militants plus radicaux et violents dont le FN ne peut se passer car ils sont garants du projet fasciste, aussi bien d’un point de vue idéologique que pratique. En effet, le RN ne pourra mener à bout son projet que via la voie institutionnelle. Il devra aussi s’imposer dans la rue et mater les institutions bourgeoises. Et qui de mieux que des militants formés politiquement, amateurs de castagne et désireux de casser du gauchiste, du pédé et de l’arabe pour guider un mouvement de masse qui aurait pour but d’écraser tout ce qui fait obstacle au projet fasciste au moment où le FN aura décidé de tomber le masque ?
C’est ainsi qu’apparaît le paradoxe du RN entre le fait qu’il n’ait pas de mots assez durs publiquement vis-à-vis des fachos violents ou ouvertement racistes et qu’il leur offre en sous main des postes d’élus, d’assistants parlementaires, de chargés de communication et qu’il fait appel à eux pour leur service d’ordre. Ils ont besoin des radicaux pour que le parti n’oublie pas ses fondamentaux mais ils ne peuvent pas pour autant leur laisser toute la place au risque de retomber dans la marginalité politique.
Crises du RN
Depuis 2011 et l’intronisation de Marine Le Pen, la dynamique du FN (en progression constante dans les urnes) fait que la stratégie de la cravate est quasi incontestée, même parmi les cagoulés. Quand tout va bien, les tensions entre la cravate et la matraque sont mises sous le tapis. Mais elles ressurgissent aux premières difficultés. Pendant le mouvement social de 1995, le fait que la gauche soit de nouveau à l’offensive a fait que le FN pouvait moins facilement apparaître comme un débouché crédible pour la colère. Dans ce contexte, et alors que Le Pen était déclaré inéligible (déjà!), le FN a traversé des turbulences. Comme c’est arrivé à de nombreuses reprises dans l’histoire du parti4, Le Pen a dû faire face à une tentative de débordement sur sa « gauche ». Mégret et la plupart des cadres, peu convaincus par la ligne radicale de Le Pen,proposent de nouer des alliances avec la droite pour accéder au pouvoir. Jean-Marie Le Pen résout la crise en excluant et en humiliant Mégret et ses lieutenants du parti et en maintenant sa ligne radicale. Le parti était affaibli mais l’autorité du chef était réaffirmée. Trois ans plus tard, le FN était au 2ème tour de l’élection présidentielle tandis que le parti de Mégret tombait dans les oubliettes.
Avec l’inéligibilité potentielle de Marine Le Pen, une nouvelle période de crise s’ouvre et avec elle, les tensions stratégiques mises sous le tapis refont surface. On l’a vu juste après l’annonce de l’inéligibilité. Certains cadres appelaient à des manifestations partout et avaient un discours public assez véhément contre les institutions et en appelant à la résistance populaire.Mais la ligne respectable l’a temporairement emporté et la colère qu’ils avaient eux-même attisée a été vite canalisée. Pas de manifestation en région mais un seul rassemblement à Paris, pour éviter tout débordement. La direction du parti aurait même préféré un meeting dans une salle pour limiter le risque de violences mais il n’y en avait pas d’assez grande de disponible en aussi peu de temps, c’est donc par défaut qu’ils ont organisé la 1ère mobilisation dans l’espace public du RN depuis des années.
Profiter des crises
Les partis fascistes revoient leurs stratégies en fonction des crises qu’ils traversent ou que traverse la société. Et sous certaines conditions (aggravation des crises économiques et politiques, poussée révolutionnaire, perte de vitesse électorale ou au contraire accession au pouvoir), les fascistes pourraient de nouveau chercher à construire un mouvement de masse et être soutenus dans cette entreprise par la bourgeoisie. Le meilleur moyen de s’assurer que les fascistes ne parviennent pas à leurs fins (c’est-à-dire notre fin), c’est de tuer leur mouvement dans l’œuf. L’œuf est déjà bien gros. L’analyse de Gramsci nous est utile, à la fois, pour ne pas baisser la garde et garder en tête que les fascistes portent plusieurs costumes mais elle nous donne aussi des pistes pour les attaquer en profitant de leurs contradictions. Gramsci nous invitait déjà en 1921 à “profiter de la période de calme relatif provoquée par les dissensions internes des bandes fascistes”.
Sauf qu’en Allemagne et en Italie, le mouvement ouvrier n’a jamais profité de ces crises. En Italie, les socialistes exhortaient à l’inaction face aux fascistes (« Restez dans vos maisons ; ne répondez pas aux provocations. Même le silence, même la lâcheté sont parfois héroïques », disait un dirigeant et se concentraient sur l’opposition parlementaire en allant jusqu’à signer avec eux un pacte de non-agression. En Allemagne, les communistes sous-estimaient le danger fasciste et combattaient les socialistes avec autant de hargne que les fascistes. Les socialistes, eux, comptaient juste sur la voie institutionnelle pour stopper les nazis. Aucun d’eux n’a su tirer profit des crises, parfois profondes, qu’ont pourtant traversé les partis fascistes.
Nous avons la possibilité de ne pas reproduire les mêmes erreurs à condition de bien cerner la menace et de la traiter en conséquence. Le retour d’un mouvement de masse fasciste incarné par le RN et sa galaxie est une option à considérer sérieusement. Pour l’instant le RN est fort dans la rue et les médias mais la présence des fachos dans la rue, bien que menaçante et croissante, reste groupusculaire.
Leur ascension est résistible à condition de faire les bons choix. Nous devons créer un mouvement antifasciste de masse, suffisamment nombreux pour empêcher (ou à minima perturber) toute apparition publique des fachos car chacune d’elles contribue à la fois à banaliser leur présence et leur permet de recruter des militants. Nous ne devons pas les laisser traduire leur puissance médiatique et institutionnelle en puissance militante. Seule l’unité d’action de tout notre camp contre les fascistes peut nous permettre d’y parvenir. Nous devons aussi, rediaboliser le RN car leur progression s’appuie en grande partie sur sa stratégie de respectabilité. En montrant son vrai visage, nous fragiliserons le bloc fasciste qu’ils construisent en compliquant leurs alliances avec la droite conservatrice et en les empêchant de recruter de nouveaux électeurs et militant.es .
Au lendemain du départ de Mégret, le FN était au fond du trou mais Ras l’Front et le reste du mouvement antifasciste n’ont pas réussi à lui porter le coup de grâce. Groupons nos forces et, cette fois-ci, finissons le travail.
Manu (Saint-Brieuc)
- Organisation d’Armée Secrète est une organisation politique fasciste qui menait un combat contre l’indépendance algérienne dès 1961. ↩︎
- Ils sont passés de lutte de classe à collaboration de classe quand la moitié d’entre eux ont accepté de créer une coalition avec la droite et ont signé un pacte de pacification avec les fascistes. ↩︎
- Un travail serait à mener sur les assises matérielles contemporaines des divergences stratégiques entre les partisans de la cravate et de la cagoule. ↩︎
- https://www.quefaire.lautre.net/La-crise-d-un-parti-fasciste ↩︎