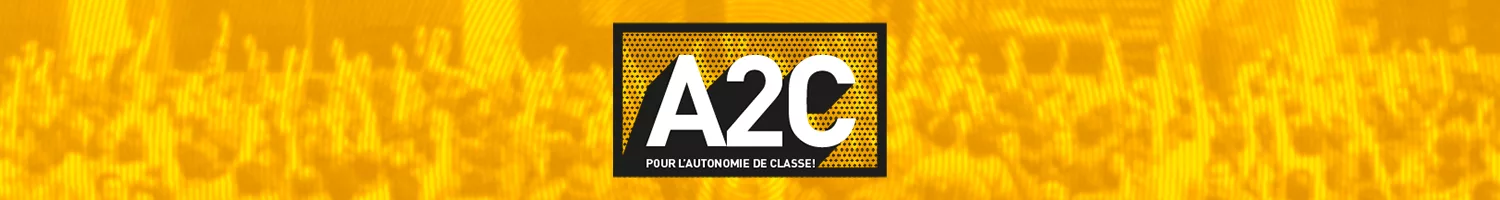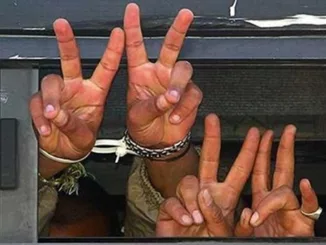Cet article explique comment la grève générale du 22 septembre s’est construite. Il fournit une source d’inspiration pour militer dans ce sens aussi en France, où les grèves politiques sont pour l’instant trop isolées1. Le 22 septembre italien nous montre que ce ne sont ni les États capitalistes, ni les partis politiques et syndicats dominants, ni une flottille ou des armées qui libéreront la Palestine, mais la classe ouvrière internationale organisée.
Il a été rédigé pour une organisation révolutionnaire irlandaise2 par Lucia Pradella, militante et universitaire marxiste
Pour faciliter la compréhension du lecteur français, vous trouverez en fin d’article une brève présentation des différentes organisations politiques et syndicales dont il est fait mention dans le texte3.
La force de la résistance palestinienne au génocide et l’écho que trouve la Flottille mondiale Sumud – elle-même inspirée par le principe de la ténacité palestinienne – ont galvanisé la jeunesse, les travailleurs et les syndicats en Italie. Le lundi 22 septembre, une grève générale sans précédent en faveur de la Palestine a paralysé certaines parties du pays, répondant à l’appel du Collectif autonome des travailleurs portuaires de Gênes (CALP/USB) à « tout bloquer ». La grève a été organisée en solidarité avec la Palestine et la flottille, pour exiger des sanctions contre l’entité sioniste et la rupture de tous les liens avec celle-ci, et pour s’opposer à la complicité de l’Italie en tant qu’allié clé et troisième plus grand fournisseur d’armes d’Israël.
Environ un million de personnes ont participé à la grève organisée par les syndicats de base (USB, CUB, ADL Cobas, SGB et SI Cobas). Les dockers et les travailleur·euses de la logistique ont dirigé les blocages pour empêcher le transport d’armes et de marchandises à destination d’Israël, fermant les portes des ports de Gênes, Salerne, Venise et Livourne. Les transports ont été perturbés dans tout le pays : les bus et les lignes de métro ont été arrêtés, les autoroutes et les gares bloquées. Environ 30 000 travailleur.euse.s du secteur public ont participé à la grève, et certaines écoles et universités ont fermé leurs portes. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans plus de 80 villes. À Milan, la police a agressé les manifestant·es qui tentaient de bloquer la gare centrale. Malgré la répression, notamment à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau, la mobilisation a dépassé toutes les attentes, attirant pour la première fois de nombreux travailleur·euses et jeunes dans le mouvement.
Sentant le vent tourner, la CGIL, la plus grande fédération syndicale du pays, a appelé à sa propre grève le vendredi 19 septembre : deux heures ou plus à l’échelle nationale, plus longtemps dans certaines régions, avec des arrêts de travail de quatre heures dans les secteurs de la métallurgie, de la construction et des services. Cette tentative de dernière minute pour affaiblir l’initiative populaire a eu pour conséquence que les travailleur·euses des services publics ont été empêché·es de participer, en raison de restrictions légales. Bien que son programme était plus restreint – limité aux couloirs humanitaires, à l’annulation de tous les accords commerciaux et militaires et à la reconnaissance d’un État palestinien –, la grève a tout de même mobilisé des milliers de personnes dans tout le pays ; certains lieux de travail ont fait état d’une participation de 100 % et les employé·es des services publics ont porté des brassards noirs en signe de solidarité.
Une lutte qui émerge des lieux de travail
Cette grève générale n’est pas sortie de nulle part. Il s’agit de la cinquième grève générale pour la Palestine en Italie depuis octobre 2023. Dirigé par des organisations palestiniennes telles que les Giovani Palestinesi Italia [Jeunes Palestiniens d’Italie, ndlt] et l’Union démocratique arabo-palestinienne [une association composée d’arabes et de palestinien.ne.s en Italie, ndlt], ainsi que par le syndicat de base SI Cobas, le mouvement pro-palestinien a donné la priorité au soutien à la résistance palestinienne en perturbant matériellement la chaîne d’approvisionnement du génocide. En plaçant la Palestine au centre des luttes sur le lieu de travail, il a montré que l’anti-impérialisme est indissociable de la lutte contre l’exploitation et le racisme dans le pays.
Opposé à la guerre inter-impérialiste entre l’OTAN et la Russie en Ukraine, SI Cobas a organisé une manifestation à la base militaire de Ghedi le 21 octobre 2023. La présence importante de drapeaux palestiniens témoignait de la force des sentiments de ses membres, dont beaucoup sont originaires d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour qui la situation en Palestine est vécue et comprise à travers un prisme commun de colonialisme, de dépossession et de résistance. Le 17 novembre, SI Cobas a répondu à l’appel des syndicats palestiniens et a appelé à la première grève générale pour la Palestine. Les travailleur·euses et les groupes palestiniens ont alors bloqué un navire israélien ZIM [compagnie de transport maritime israélienne, spécialisée dans le transport de conteneurs, ndlt] à Salerne et organisé un piquet de grève à Modène devant l’entreprise Tekapp, un fabricant d’équipements électroniques militaires pour Israël. Le lendemain, des milliers de personnes ont défilé à Bologne.
Le 23 février, SI Cobas a appelé à une deuxième grève générale en soutien à la Palestine, en collaboration avec les Giovani Palestinesi Italia et avec le soutien de la plupart des syndicats de base, impliquant également 20 000 travailleur·euses du service public. La manifestation nationale à Milan a rassemblé environ 50 000 participant.e.s – la plus grande mobilisation populaire jusqu’à cet été 2025 – et s’inscrivait dans le cadre d’une journée internationale d’action contre les guerres dans la capitale.
Les tactiques se sont intensifiées au cours du printemps : barrages, piquets de grève hebdomadaires devant les services publics, occupations de gares ferroviaires et manifestations devant des usines d’armement comme Leonardo et la chaîne de télévision nationale RAI. À Gênes, la pression publique soutenue exercée par le mouvement de solidarité et SI Cobas a contraint la compagnie municipale d’énergie Iren à annuler un contrat avec la société israélienne Mekorot. Le 8 mars 2024, SI Cobas a de nouveau appelé à faire grève, qualifiant Leonardo d’« usine militaire de la mort » et établissant un lien direct entre la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et la lutte contre le militarisme et la violence sioniste.
Les membres de SI Cobas ont activement soutenu et rejoint les campements étudiants. Inspirés par eux, les travailleur·euses en grève de Dachser-Fercam à Bologne Interporto ont exigé en mai la fin du traitement des marchandises à destination et en provenance de l’entité sioniste et ont obtenu gain de cause, obtenant l’inscription de cette clause dans leur contrat. Le même mois, les travailleur·euses de Plaisance ont organisé l’expédition d’environ 19 tonnes de produits de première nécessité à destination de Gaza via le passage frontalier entre l’Égypte et Rafah, et ont continué depuis à organiser le soutien matériel.
Le 24 juin 2024, en collaboration avec des organisations palestiniennes, SI Cobas a appelé à une grève nationale de la logistique qui a abouti le lendemain au blocus du port de Gênes. Dès l’aube, les travailleur·euses et les militant·es ont fermé les portes de San Benigno, Albertazzi et Etiopia avant de se diriger vers la porte Ponente, fortement surveillée par la police, paralysant ainsi une grande partie du port. La décision de SI Cobas de faire grève pour soutenir le blocage a entraîné des frictions avec les syndicats CALP et USB, mettant en évidence des divergences sur les tactiques, la stratégie et l’orientation politique. Un militant palestinien m’a confié :
« Même si ces grèves ont été limitées dans leur portée, elles ont eu une valeur énorme car elles ont introduit une méthode qui peut être reprise. Nous avons commencé par de petites actions, et ces actions ont pris de l’ampleur. Même lorsqu’elles n’ont pas été immédiatement reproduites, le mot d’ordre de ces blocages s’est transmis, et c’est extrêmement important. »
La réaction de l’État confirme cette analyse. Les militant.e.s établissent un lien entre les mesures policières prises contre les piquets de grève chez Leonardo et la RAI et la volonté du gouvernement d’adopter un nouveau « décret sur la sécurité ». Le projet de loi proposait d’étendre les pouvoirs de la police, d’introduire des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans pour le blocage d’infrastructures, de criminaliser les révoltes dans les centres de détention pour immigrants et les prisons, et de punir le « terrorisme verbal ». Il est significatif que le ministre de l’Intérieur, Piantedosi, ait explicitement justifié le décret en citant les blocages logistiques et le SI Cobas comme des menaces à neutraliser.
La Palestine et la lutte contre la répression
Au lieu de s’unir pour faire face à cette escalade, les divisions au sein du mouvement ont limité son potentiel. Au cours de l’été, le mouvement de solidarité à la Palestine s’est joint à l’opposition populaire au projet de loi, ce qui a conduit à la création du réseau Rete Liberi/e di lottare. Même les membres de la CGIL et de l’UIL ont commencé à se mobiliser contre ce projet. Pour de nombreux·ses militant·es, cela a rendu encore plus cruciale la manifestation pour la Palestine et le Liban organisée le 5 octobre à Rome. Mais le gouvernement a interdit la marche. Après l’interdiction, certains dirigeants de la communauté palestinienne (liés à l’Autorité palestinienne) ont pris leurs distances, invoquant des considérations tactiques, tandis que d’autres ont insisté pour que la marche ait lieu, arguant que l’enjeu réel était le soutien inconditionnel à la résistance palestinienne et le refus de normaliser l’occupation.
La marche, qui a eu lieu malgré l’interdiction, a prouvé la détermination des manifestant·es face à une répression sans précédent : la police a arrêté et fouillé plus de 1 600 manifestant·es dans les gares, aux péages et sur les lignes de bus, et a émis 51 ordres d’expulsion de la capitale. La manifestation elle-même a été confinée à une place fortement militarisée, tandis que quatre personnes ont été arrêtées à la suite d’accusations et de provocations policières. Les militant·es ont averti qu’il ne s’agissait là que d’un avant-goût des pouvoirs répressifs plus étendus du décret. L’esprit de défi s’est poursuivi au cours des semaines suivantes, culminant avec la grève nationale du 18 octobre appelée par SI Cobas et Rete Liberi/e di lottare et la manifestation nationale du 19 octobre contre la guerre, la répression et le nouveau projet de loi sur la sécurité.
Dans le même temps, un réseau lié à la gauche parlementaire a vu le jour, organisant de grandes manifestations contre le projet de loi, mais refusant de les relier à la Palestine, à l’économie de guerre ou à des actions perturbatrices. Des divisions au sein du mouvement pro-palestinien ont éclaté avant une assemblée organisée par Potere al Popolo, Rete dei Comunisti et USB début novembre. Les Giovani Palestinesi Italia ont refusé d’y participer. Dans une lettre ouverte, ils ont accusé les organisateur·ices de mettre les groupes palestiniens sur la touche et de chercher à créer une coordination italienne qui déciderait des stratégies « comme si la Palestine était une cause extérieure ». Les préparatifs de la grève générale du 29 novembre ont encore accentué ces divisions : la CGIL et l’UIL ont appelé à une grève générale contre le budget du gouvernement et le projet de loi, tandis que le SI Cobas, la CUB et la SGB – mais pas l‘USB – ont fait grève sur une plateforme reliant l’opposition à l’économie de guerre et à la répression avec la solidarité à la Palestine et au Liban. À la veille de la marche, les groupes palestiniens sont intervenus pour empêcher la fragmentation de l’opposition et obtenir un soutien sans équivoque à la résistance, ce qui a conduit à une manifestation unique de plus de 30 000 personnes, sur la base de la grève générale de la veille.
L’incapacité à créer un front uni à partir de la base, ancré dans la résistance sur le lieu de travail, a finalement affaibli ces mobilisations. Le 11 avril 2025, SI Cobas a appelé à une grève générale qui combinait des revendications sur le lieu de travail (augmentation des salaires, réduction du temps de travail, interdiction des licenciements et de l’externalisation) et des revendications politiques (opposition au réarmement européen, à la répression étatique et à la complicité de l’Italie dans le génocide). En collaboration avec des organisations palestiniennes et le mouvement des chômeur·euses de Naples, la grève a touché des centres logistiques clés à Milan et Bologne, où un blocage de six heures à l’Interporto a provoqué de longues files de camions et des perturbations sur les autoroutes, tandis que les manifestant·es ont pris pour cible les ports de Gênes, Naples et le centre Rubiera à Reggio Emilia, utilisé par Maersk pour expédier des composants de F-35 [avion de chasse américain, utilisé par Tsahal, ndt] de Leonardo. La grève a été suivie, le 12 avril, d’une grande manifestation nationale à Milan, qui a une fois de plus été réprimée brutalement par la police, notamment par des agents portant des insignes néonazis – célébrant probablement les pouvoirs élargis qui leur avaient été accordés par le nouveau décret, entré en vigueur ce jour-là.

Des blocages aux grèves générales
La répression étatique n’a toutefois pas réussi à étouffer l’indignation croissante suscitée par le génocide perpétré par Israël, ses agressions contre sept pays de la région et la complicité directe de l’Italie. En juin, les docker·euses français·es et italien·nes ont réussi à bloquer environ 14 tonnes de munitions destinées à Israël, prolongeant ainsi une série de blocages portuaires coordonnés à travers l’Europe. En septembre, un comité de docker·euses nouvellement formé à Ravenne a obtenu des autorités locales qu’elles bloquent deux conteneurs remplis d’explosifs à destination de Haïfa. Dans ce contexte, les partis d’opposition parlementaires – le Parti démocrate (PD), le Mouvement cinq étoiles et l’Alliance verte et de gauche (AVS) – ont organisé une grande marche à Rome début juin pour dénoncer le gouvernement de Netanyahu et appeler à la « paix ». Dans le même temps, la police de Milan a interdit une manifestation organisée par la Palestine pour demander la fin des relations entre l’Italie et Israël.
Avant le sommet de l’OTAN qui s’est tenu en juin à La Haye – et qui a engagé les États membres à augmenter leurs dépenses militaires à 5 % du PIB d’ici 2035 –, l’USB, SI Cobas et d’autres syndicats de base ont organisé une grève générale établissant un lien entre la guerre et le génocide à l’étranger et l’économie de guerre dans leur pays : attaques contre les salaires et les conditions de travail, démantèlement de la protection sociale, augmentation de la pauvreté, criminalisation de la dissidence, intensification du racisme d’État et des violences policières. Comme l’a expliqué un coordinateur de SI Cobas, l’État cible particulièrement les travailleur·euses immigré·es, qui sont à l’avant-garde des luttes syndicales en Italie et du mouvement de solidarité avec la Palestine :
« À mesure que le conflit s’intensifie, ils renforcent les lois qui répriment et ciblent les immigré.e.s. Ce n’est pas un hasard si nous sommes celleux qui sommes visé·es. »
La stratégie de l’État était claire : cibler les travailleur·euses immigré·es dans le secteur de la logistique afin d’empêcher la propagation de cette radicalité au sein de la classe ouvrière organisée. Mais le 20 juin, cette barrière a cédé : les métallurgistes se sont également mis en grève pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail, et à Bologne, 10 000 manifestant·es ont quitté le parcours autorisé et occupé le périphérique, paralysant l’une des artères principales de la région pendant environ 45 minutes. La police a menacé de les poursuivre en vertu du nouveau décret, montrant ainsi à quelle vitesse la contestation syndicale peut dépasser les limites fixées par les dirigeants syndicaux et comment la répression attise la résistance au lieu de l’arrêter.
Comme l’a dit un militant : « La Palestine bouleverse tout, radicalise la jeunesse. » C’est précisément ce potentiel que les partis traditionnels et les dirigeants syndicaux se sont empressés de contenir. Le 21 juin, Rome a accueilli deux marches distinctes contre la guerre, le réarmement et le génocide perpétré par Israël à Gaza. Stop Rearm Europe : Welfare, not Warfare (Arrêtez le réarmement de l’Europe : des services publics, pas la guerre), soutenu par les partis traditionnels et la CGIL, a rassemblé plus de 100 000 personnes, mais sur une plateforme de pacifisme générique qui évitait soigneusement de s’opposer à l’OTAN. Disarmiamoli ! – une initiative principalement menée par Potere al Popolo et USB – était plus virulent dans ses slogans anti-OTAN, mais ne critiquait pas les puissances rivales telles que la Russie et la Chine. Les organisations palestiniennes et SI Cobas ne se sont pas non plus officiellement jointes au mouvement. Cela a révélé à la fois la fragmentation continue du mouvement et le fait qu’après 18 mois de blocus et de grèves, les partis d’opposition avaient été contraints de descendre dans la rue – uniquement pour canaliser la colère vers une opposition électorale sans risque et des revendications en faveur d’un rôle plus important pour l’UE.
La Global Sumud Flotilla a gagné en nombre de participant·es et en visibilité, mais a également risqué de transformer la libération de la Palestine en une cause humanitaire gérée par des ONG et des partis traditionnels, soulageant ainsi la pression non seulement sur les gouvernements occidentaux, mais aussi sur les BRICS, également complices, tout en contournant les organisations palestiniennes. Un jeune militant m’a confié que sans la participation et la position politique du CALP, la Flottille aurait constitué un recul pour le mouvement pro-palestinien en Italie, qui avait axé son action sur les grèves, les blocages et la solidarité avec la résistance. Le mouvement a directement défié les politiciens de centre-gauche qui cherchaient à exploiter le moment pour se présenter comme des alliés. À Gênes, les militants les ont confrontés en scandant « Sionistes, hors de nos luttes! ». Un coordinateur du SI Cobas m’a déclaré :
« L’unité doit se construire entre les travailleur·euses, pas avec les patrons, les maires sionistes et celleux qui ont soutenu le génocide et voté à l’unanimité en faveur de la mission navale ASPIDES menée par l’Italie en mer Rouge contre la résistance yéménite.»
L’explosion de force, de colère et de jeunesse du 22 septembre a montré que le vent est en train de tourner. Le mouvement a pris une ampleur telle que les partis d’opposition, les dirigeants syndicaux ou l’État ne sont plus en mesure de le contenir. Une fois de plus, la Palestine est devenue la cause qui rallie les masses opprimées et exploitées de notre époque. Elle n’appartient à aucun syndicat ni à aucun parti, mais aux masses elles-mêmes, qui doivent prendre la lutte en main et construire une véritable unité à partir de la base. Cette percée n’est pas un miracle : elle est le résultat de deux années d’organisation soutenue menée par les Palestinien·nes et les travailleur·euses, confirmant que le pouvoir des travailleur·euses est décisif pour affronter le sionisme et l’impérialisme en Occident. À Livourne, un blocus de trois jours a contraint les autorités à annoncer que le navire militaire américain SLNC Severn ne pourrait pas accoster. À Salerne, un blocus sans précédent du terminal à conteneurs a contraint son exploitant à négocier la suspension des liaisons maritimes vers Israël et l’annulation des contrats avec ZIM et toute autre entreprise complice.
Alors qu’Israël intensifie son génocide et attaque la flottille, il est urgent d’intensifier la lutte : nous devons œuvrer en faveur d’une grève générale unifiée, coordonnée au niveau international et capable de s’attaquer à l’impérialisme à la racine. La solidarité doit se traduire par des perturbations partout : nous devons « tout bloquer » jusqu’à ce que la Palestine soit libre.
Notes :
- Lire l’article : « Gaza : de la solidarité massive à la grève politique » dans la revue #18 pour un témoignage militant d’une grève menée dans ce sens ↩︎
- https://rebelnews.ie/2025/09/25/block-everything-workers-strikes-and-palestine-solidarity-in-italy/ ↩︎
- CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) : Collectif Autonome des Travailleurs Portuaires de Gênes, collectif de travailleur.euse.s portuaires explicitement antifasciste et antimilitariste, affilié au syndicat USB, et qui a organisé régulièrement le blocage de navires transportant des armes à destination d’Arabie Saoudite, de Syrie ou d’Israël.
USB (Unione Sindacale di Base) : Syndicat italien de lutte des classes et internationaliste. Prend régulièrement position contre la guerre, le racisme et pour l’accueil des exilé.e.s. Fait partie de la FSM (fédération syndicale mondiale, auquel participe, en France, notamment l’Union Départementale CGT des Bouches du Rhône, et les fédérations CGT de la Chimie et de l’agro-industrie). Compte environ 250 000 membres.
CUB (Confederazione Unitaria di Base) : Syndicat italien de lutte des classes, mais moins explicitement politique et plus orienté sur les revendications socio-économiques. Syndique près de 700 000 travailleur.euse.s.
SI Cobas (Sindacato Intercategoriale Cobas) : Surtout présent dans la logistique, il défend notamment les travailleur.euse.s précaires et organise souvent des actions d’occupation ou de blocage très médiatisées.
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) : Plus grande confédération syndicale italienne (+ 5 millions d’adhérent.e.s, actif.ve.s et retraité.e.s. Membre, comme la CGT, la CFDT, la CFTC et FO de la Confédération Syndicale Internationale).
UIL (Unione Italiana del Lavoro) : Autre grande confédération syndicale italienne, de type réformiste social-démocrate. Membre également de la Confédération Syndicale Internationale.
Rete dei Comunisti (Réseau communiste) : Organisation politique marxiste-léniniste italienne.
Potere al Popolo : réseau citoyen démocratique et anticapitaliste ↩︎