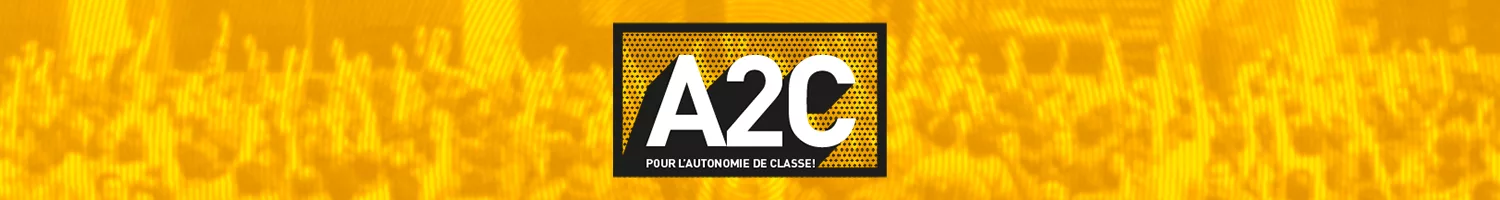Depuis le 7 octobre 2023, les manifestations massives ont montré la solidarité des travailleurs, travailleuses et de la jeunesse dans le monde entier, rassemblant des millions de personnes dans plus de 100 pays, y compris en France et dans d’autres États impérialistes. Malgré cette force, les massacres se poursuivent et la répression ne cesse pas. Il faut donc construire des stratégies efficaces : les manifestations et les campagnes de boycott ne suffisent pas, il faut travailler à l’unité des travailleurs et à l’organisation de la grève, tout en dénonçant clairement l’impérialisme français.
Pour une riposte syndicale à l’impérialisme
On entend souvent que le syndicat se limite aux conditions de travail, aux salaires et aux droits, et qu’un bon syndicaliste doit surtout défendre les intérêts immédiats des travailleurs. Pourtant, la solidarité internationale fait partie des traditions du mouvement ouvrier. Il faut certes parler des conditions de travail et des salaires, mais aussi de tout ce qui structure cette société capitaliste, notamment la guerre et les génocides. Le mouvement syndical n’a rien à perdre à s’engager activement dans ce combat. Au contraire, il a tout à y gagner : retrouver de la force, reprendre sa place et contribuer à l’unité de l’ensemble des travailleurs.
Le mois de juin a montré par l’exemple que des mobilisations d’ordre politique sont possibles. Plusieurs lieux de travail en France se sont mobilisés pour dénoncer le génocide et bloquer les soutiens à Israël. Au Sénat, les travailleurs de la CGT se sont mobilisés lors de la venue d’un ambassadeur israélien. Le 1er juin, la CGT Décathlon a appelé à une grève pour le désengagement de l’entreprise de ses liens avec Israël. Le 4 juin, les dockers ont empêché la livraison d’armes pour Israël, en collaboration avec les dockers de Gênes. Le 14 juin, l’intersyndicale a appelé à une série de rassemblements en France. À peu près au même moment, les syndicats de l’aéroport de Roissy ont appelé à ne pas participer à la livraison d’armes vers Israël. Enfin, le 17 juin, en région parisienne et à Marseille, plusieurs syndicats de l’éducation ont appelé à une grève contre le génocide et contre la répression des enseignant.es. Ces exemples prouvent que les mobilisations directes contre la guerre et le génocide sont non seulement possibles, mais sont déjà une réalité dans nos lieux de travail.
Un contexte pour l’offensive
En plus des manifestations hebdomadaires dans toutes les villes en France, des actions régulières s’inscrivent dans la continuité des campagnes BDS, appelant au boycott des entreprises liées à Israël. Elles mettent en lumière le rôle de la France dans la colonisation de la Palestine, notamment par l’acheminement d’armes et par divers accords économiques. Depuis deux ans, toutes ces mobilisations rencontrent la répression de l’État, qui cherche à faire taire les voix de résistance et à affaiblir notre capacité à nous organiser. L’Éducation nationale participe à cette silenciation en sanctionnant des collègues qui refusent de se taire face au génocide en cours. À Sens, la répression à l’encontre d’une collègue d’abord suspendue puis blâmée en mai dernier pour avoir organisé une minute de silence a provoqué une vague d’indignation dans l’éducation.
Le véritable moteur de cette mobilisation n’a pas été la répression, mais la prise de confiance dans notre capacité à agir. Si des camarades et collègues se sont rassemblés, voire ont fait grève, c’est avant tout parce qu’un contexte global de mobilisations massives a permis de prendre confiance. En effet, le convoi Soumoud ainsi que les immenses manifestations suite à l’arrestation de la flottille ont montré la force des masses qui se soulèvent. Bien plus forte que la répression, la vision de milliers de personnes qui, par la marche ou par la mer, tentent de braver les frontières pour briser le blocus israelien, est pour nous toutes et tous un élément de confiance pour agir. C’est dans ce contexte que nous avons pu nous rassembler et tenter une offensive par la grève, afin de montrer, comme d’autres, que dans nos lieux de travail nous pouvons nous mobiliser.
Grève de juin
Des camarades syndicalistes ont organisé cette grève, pendant que dans plusieurs autres villes en France avaient également lieu des rassemblements condamnant la sanction contre notre collègue de Sens. Pour permettre cette journée de grève, un travail à la base a été fait.
Elle a été construite dans les bahuts, par des assemblées générales souvent par les sections syndicales d’établissement. À Paris comme à Marseille, plusieurs camarades sont intervenu.es auprès de leurs collègues, dans leur établissement ou dans leur union locale pour entamer des discussions sur la possibilité de se mettre en grève contre le génocide et la répression. Ces initiatives ont réuni plus de 100 personnes à Marseille, l’un des plus gros rassemblements de l’année devant l’inspection académique, et on compte trois vies scolaires complètement en grève. À Paris, près de 500 personnes se sont rassemblées devant le ministère de l’Éducation nationale. Dans les deux cas, malgré le peu de temps, là où un travail militant de terrain a été fait, des personnels se sont mobilisés. Cela s’est également vu dans des établissements pas encore convaincus ou incertains sur la grève, qui ont pu, avant ou après, réaliser des actions de visibilisation (banderoles et pancartes) devant leur établissement.
Au-delà de la mobilisation, la construction de cette grève doit participer à répandre l’idée que nous pouvons montrer concrètement notre solidarité avec le peuple de Palestine depuis nos lieux de travail et par la grève. Cet exemple participe à montrer que nous pouvons nous organiser et nous mettre en grève en soutien à la Palestine.
Il faut convaincre nos syndicats de l’importance de s’engager dans de tels mouvements, car, par leur capacité à mobiliser et à faire résonner les revendications, ils sont essentiels pour amplifier le mouvement.
Mais il faut aller plus loin pour continuer à répandre l’idée que les travailleurs et travailleuses possèdent le pouvoir de tout renverser, et même, qu’ils sont les seuls à pouvoir changer quoi que ce soit à la situation en Palestine.
La classe ouvrière comme force centrale
La grève des personnels de l’Éducation en juin est un premier pas, qui nous rappelle que les travailleurs ont déjà changé le cours des luttes internationales. Par exemple, en 1984, Mary Manning, une ouvrière de 21 ans de Dunnes Stores en Irlande, refuse, suite aux directives syndicales, de vendre un pamplemousse venant d’Afrique du Sud. À la suite de ce refus, elle est suspendue. En solidarité, dix autres caissier·es du magasin la rejoignent dans une grève qui durera près de trois ans. Cette mobilisation exceptionnelle contre l’apartheid montre que cela est possible. Plus encore, la grève se termine en 1987, lorsque le gouvernement irlandais interdit l’importation de produits en provenance d’Afrique du Sud. Cette grève nous rappelle toute la puissance des travailleurs et travailleuses qui, par leur action, peuvent tout changer. Aujourd’hui encore les travailleurs et travailleuses détiennent la clé de la libération de la Palestine.
Ce qu’il faut construire maintenant
Chaque lieu de travail, chaque secteur qui prend l’initiative fournit la confiance est un point d’appui pour les autres. A l’image des dockers de Gênes qui ont annoncé qu’ils déclencheront une grève si les passager·es de la grande flottille qui doit arriver à Gaza mi-septembre se font arrêter. Il est de notre responsabilité, en tant que syndicaliste, de tout faire pour que cet appel trouve un écho, non seulement parmi les travailleurs portuaires, mais aussi parmi tous les travailleurs et travailleuses qui souhaitent briser le blocus de Gaza.
Il est donc crucial de faire de la grève politique un outil puissant pour transformer la solidarité en pression concrète. Les travailleurs et travailleuses ont le pouvoir de changer le cours des événements, non seulement en France, mais aussi à l’échelle internationale. Dans cette période de regain de militarisation, militons pour que nos lieux de travail s’engagent dans le soutien aux peuples opprimés et le combat contre l’impérialisme français.
Yassine, A2C Marseille