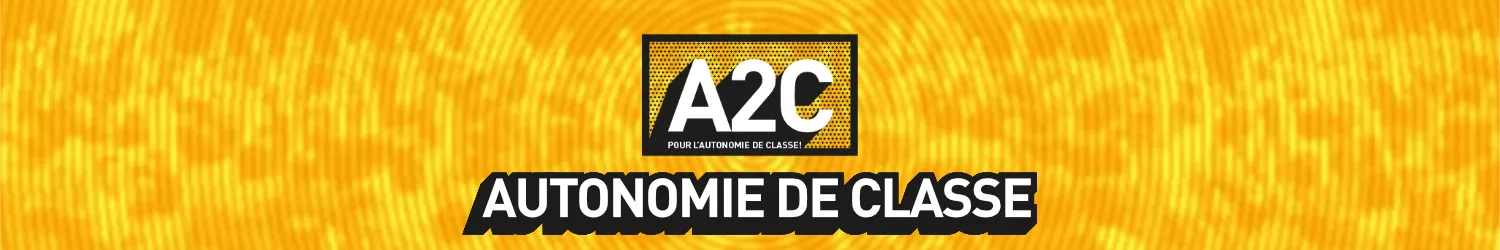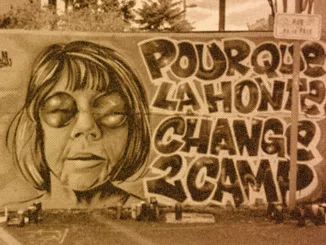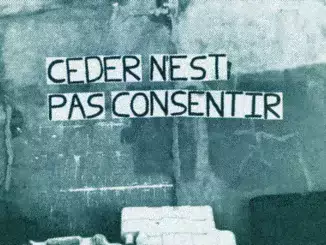Un spectre très large de mouvements féministes (ou pseudo-féministes) revendiquent l’intégration du consentement dans la définition du viol. Cette revendication, aboutissant à des stratégies différentes voire opposées, ne doit pas être vue comme un terrain neutre mais comme un champ de bataille politique. Ainsi, nous devons questionner la place du consentement dans l’élaboration de nos outils et dans nos stratégies de lutte contre les violences sexuelles (VS) et nous demander si la notion de consentement est suffisante pour lutter contre les VS, dans nos organisations et dans la société. Dans nos cadres d’intervention, des camarades sont parfois suspendus, protégés ou encore dénoncés en public. Face à ces situations, il n’est pas facile de savoir comment réagir. Nous avons donc besoin d’une boussole éthique et politique.
Les Cahiers d’A2C #19 – Novembre 2025

LE CONSENTEMENT : ÉTAT DES LIEUX
Le fondement de la légitimité des rapports sexuels
Le consentement est l’acquiescement donné à un projet ou un acte. Il s’applique dans beaucoup de domaines du droit, comme en droit de la famille où l’on consent à un mariage. L’énonciation de cette notion dans la loi montre que ce n’est pas une évidence. Le consentement a besoin d’être légiféré. Mais qu’en est-il dans le domaine des violences sexuelles ?
En France, nous sommes dans une période de changement de la définition légale des VS. Depuis 1980, elle est basée sur la notion de « contrainte ». Une VS est défini comme un acte sexuel imposé par la violence, la menace ou la surprise. Le consentement n’était pas évoqué. Depuis quelques années, des agences de l’ONU préconisent une approche des VS basée sur l’absence de consentement. Des États l’ont alors intégré à leurs lois comme l’Allemagne (2016), la Suède (2018), l’Espagne (2022).
Depuis 2023, un débat existe en France à ce sujet. Les mouvements féministes appellent à une réforme du droit pénal pour reconnaître tout acte sexuel sans consentement comme une violence. Depuis octobre 2025, la France a inscrit ce principe dans la loi sur la caractérisation des VS.
L’absence de consentement pour caractériser les VS semble évidente, mais l’utilisation de cette notion n’a pas toujours abouti aux mêmes stratégies politiques contre le patriarcat.
Clara Serra, philosophe et essayiste espagnole, expose deux tendances ayant émergé de ce point de départ.
Le consentement impossible
La première tendance est celle du féminisme de la domination, qui s’appuie sur le féminisme matérialiste. Ici, le patriarcat est compris comme un système social et historique d’oppression des femmes par les hommes, qui s’appuie sur des structures matérielles, économiques et sociales. Cette structure sert alors le pouvoir d’un groupe (les hommes) au détriment d’un autre (les femmes). Elle organise l’ensemble des rapports entre ces groupes (le mariage, le travail ménager ou encore la sexualité). Dans ces conditions, consentir devient impossible.
La première stratégie qui découle de cette idée est le séparatisme. Puisqu’il ne peut pas y avoir de sexualité consentie sous le patriarcat, et donc dans les relations hétérosexuelles, le choix de la séparation s’impose pour se libérer des VS. Cela amène au lesbianisme politique, aux communautés de femmes, et à l’organisation politique en non-mixité.
La deuxième stratégie est l’élaboration d’un appareil législatif prohibitionniste et anti-sexe. Aux États-Unis, Andrea Dworkin et Elisabeth McKinnon ont déduit que le sexe est violence et donc que la sexualité est un danger pour les femmes. La pornographie et le travail du sexe (TDS) en deviennent les symboles ultimes. Pour protéger les femmes, elles se sont tournées vers l’État pour mettre en place des politiques prohibitionnistes (lois anti-avortement et anti-pornographie notamment). Cette politique a eu pour conséquences le harcèlement policier des TDS, des lieux gays, lesbiens et trans, l’absence de prise en compte des débuts de l’épidémie de VIH et la mise en place de programmes éducatifs basés sur l’abstinence avant le mariage.
Le consentement comme horizon souhaitable
L’autre tendance est celle du néolibéralisme sexuel, selon laquelle « seul un oui est un oui ». Dans cette perspective, il est nécessaire de s’examiner, de regarder son désir, le comprendre, le verbaliser pour dire oui et contractualiser un accord. Sur ce terrain consenti contractualisé, il n’y a plus de risques de violences sexuelles.
La différence avec la première théorie est que la sexualité n’est pas forcément perçue comme une violence. Pour distinguer une violence d’une sexualité consentie, notre désir et notre capacité à l’exprimer ou non sont centraux. Aussi, dans la première tendance, la gestion des VS est déléguée à l’ État alors que la deuxième amène à des devoirs individuels : des hommes, on exige qu’ils demandent et des femmes, qu’elles sachent répondre. Cette vision du consentement est celle du capitalisme qui nous enjoint à être libres en trouvant nous-mêmes les conditions de notre liberté, sans nous en donner la possibilité.
Clara Serra nous dit que les deux théories coexistent. L’intégration dans les législations d’une définition positive du consentement mène à des lois plus répressives tout en demandant à chaque individu de se responsabiliser seul.
Évidemment, l’idée de consentement reste essentielle, mais elle est insuffisante. Il est nécessaire de contextualiser les conditions du consentement pour savoir si la capacité à consentir existe ou non.
Aujourd’hui, cette capacité et les violences sexuelles existent dans le contexte du patriarcat. Celui-ci est un outil essentiel au capitalisme car il assure la reproduction de la force de travail. Les VS, normalisées et naturalisées par la culture du viol, y sont un outil de domination et de maintien de l’ordre social.

LE SEXE COMME VIOLENCE OU LA CONQUÊTE DU DÉSIR
Les Feminist Sex Wars
Les Feminist Sex Wars désignent les conflits autour du sujet de la sexualité entre plusieurs mouvements féministes. Elles débutent dans les années 80 aux États-Unis, au moment où sont votées les lois réactionnaires de Reagan. Ces controverses se cristallisent, en surface, sur la question de la pornographie. En réalité, « [elles sont] un combat pour savoir qui a le droit de définir la sexualité féminine » : l’État ou les personnes elles-mêmes ? Elles nous donnent un éclairage sur la manière dont nous pouvons aborder la question des VS et la sexualité plus largement.
L’un des camps des Sex Wars est celui des féministes dites radicales. Elles considèrent que la pornographie, le BDSM ou les relations butch-fem reproduisent la domination masculine et perpétuent les violences, même si elles semblent consenties. Cette idée aboutit à la stratégie d’un État qui promeut des lois anti-sexe. L’autre camp, celui des pro-sexe, lié aux luttes queers et à la défense des TDS, pense que le mouvement féministe doit s’engager contre la répression sexuelle. Il propose d’aller à la conquête du plaisir, par la libération du désir, une dépénalisation des fantasmes et la possibilité de jouer avec les codes du genre. Ce courant conçoit le consentement comme un critère libérateur permettant la distinction entre sexualité et violence.
S’inspirer des « pro-sexe » pour bâtir nos boussoles paraît intéressant, tout en conservant deux vigilances :
- Des héritier·es de ce courant (comme Foucault, Hocquenghem, De Beauvoir) ont poussé si loin l’exploration de cette liberté qu’ils ont encouragé les violences sexuelles faites aux enfants.
- Ce courant peut amener à des stratégies qui imaginent que ce sont nos pratiques individuelles de dissidences et de subversions qui vont mettre en danger le système (dominantes dans les pensées queers).
La conquête du désir dans un contexte de backlash ?
Bien que la stratégie pro-sexe nous semble pertinente, il est important de rappeler que nous sommes actuellement dans une période de backlash, où les droits et les libertés gagnées autour de la sexualité sont en recul.
En témoigne la polémique, en France, autour de la loi EVARS (le programme d’éducation à la vie affective et sexuelle de l’Éducation nationale). Ce programme paraît une bonne piste pour garantir de meilleures conditions pour consentir ou non, et il fait l’objet d’une lutte acharnée de la part des milieux conservateurs et des fascistes. Au niveau institutionnel, le RN a déposé en avril 2025 une proposition de loi alternative qui remet la naturalisation de la famille hétérosexuelle et la biologisation du genre au centre de la société, tout en reconnaissant la nécessité de protéger les femmes des violences. Cette lutte s’articule aussi par une mise en mouvement. Début mars 2025, une grève de l’absentéisme, appelée par des groupes de parents type Syndicat de la Famille, héritiers de la Manif pour Tous et liés au RN et à Reconquête, a été assez suivie, vidant en partie des classes de leurs élèves.
Récemment, au Royaume-Uni, la Cour Suprême a acté que les femmes sont définies par leur biologie. L’attaque anti-trans est évidente, mais cet événement est à replacer dans le contexte de menace de guerre actuel. En France, Macron a appelé au « réarmement démographique », et dans tous les États impérialistes, des politiques de natalité sont ou vont être mises en place. Or, pour que la natalité redémarre, tout le monde doit être ramené sur le chemin de l’hétérosexualité. Cette contrainte repose sur la généralisation des violences sexuelles, notamment envers les personnes LGBT+.
Dès lors, la notion de consentement ne semble pas suffisante pour lutter contre les VS. Elle peut même parfois être dangereuse, selon par qui et au service de quoi elle est utilisée. Mais alors comment organiser efficacement la lutte contre les VS ?

LUTTER CONTRE LES VS AU-DELÀ DE L’IDÉE DU CONSENTEMENT
Lutter contre un système
Dans un premier temps, nous n’avons pas d’autre choix que de lutter contre tout le système qui produit les VS : le patriarcat et le capitalisme. Cependant, la conséquence ne doit pas être de se satisfaire d’un investissement dans son syndicat. Nous devons considérer le sexisme, au sein de nos organisations, comme un des fronts de la lutte des classes. Cela, à la fois parce que le féminisme politise et organise massivement, mais aussi parce qu’une partie des attaques les plus virulentes contre notre classe se fait sur le front du sexisme.
Il est donc essentiel de prendre au sérieux le mouvement féministe pour gagner des arguments. Nous devons aussi continuer à voir la mobilisation du 8 mars comme une possibilité d’organisation de notre classe.
Que faire des personnes ayant commis des violences ?
Une de nos idées de base est de refuser de clamer « pas d’agresseurs dans nos rangs », tout simplement car nous ne croyons pas à cette possibilité, sous les conditions actuelles.
Nous ne sommes pas en mesure de créer une micro-société dans laquelle nous aurions supprimé toutes les violences, car nous en sommes tous et toutes capables.
Mais alors qu’attendons-nous de nous qui produisons ces violences (même sans le vouloir) ? De suivre ce qui est demandé dans le cadre du protocole que nous avons élaboré pour montrer patte blanche ? Est-ce que ça serait la garantie de ne pas recommencer ? Ou souhaitons-nous plutôt une transformation profonde de la société ?
Comme nous, féministes révolutionnaires, pensons que le patriarcat ne profite pas à « une classe d’hommes » mais plutôt à la société capitaliste, nous proposons de sortir le désir du champ de la violence pour qu’il devienne un terrain d’expérimentation et de libération pour tout le monde. Nous pensons que tout le monde peut changer, en profondeur, et en parallèle d’un changement des conditions matérielles conditionnant nos actions. Ainsi, arrêter de faire subir des violences sexuelles, ce n’est pas perdre quelque chose mais plutôt gagner des formes d’interaction non basées sur la violence.
Les personnes ayant subi des violences
Il est essentiel de reconsidérer la place totalisante de victime dans laquelle les personnes qui subissent des violences sont placées. Considérer ces personnes comme étant dotées de désir, dans toutes ses contradictions, c’est leur redonner du pouvoir. Cela permet de discuter avec nos camarades et d’exprimer des désaccords sur la gestion des situations de violences sans sacraliser « la parole de la victime ».
Enfin, cela permet de rester fidèle à l’idée que même si notre classe subit des violences, c’est en elle que réside les possibilités de son émancipation. Alors, on doit garder comme principe premier de donner les conditions nécessaires à nos camarades ayant subi des VS pour pouvoir continuer à militer, parce que c’est grâce à chacun·e d’entre nous que nous pourrons lutter contre le système qui produit ces violences.
MARIA MARTIN (RENNES)
À ÉCOUTER
GRÈVE FÉMINISTE, GRÈVE DU TRAVAIL REPRODUCTIF OU GRÈVE DE LA PRODUCTION ?
Dans cette introduction nous essayons de revenir sur la construction du 8 mars comme date de grève féministe. Si le mouvement féministe a réussi à imposer ce mot d’ordre à l’international, il est difficile de savoir comment elle se construit effectivement. La grève est parfois agitée comme une revendication sans que le mouvement la construise activement par en bas, dans leurs syndicat et leur quartier. Nous avons décider de revenir sur ce qu’est une grève féministe. Est-ce qu’il s’agit d’une grève des femmes ? D’une grève du secteur reproductif ? Ou bien d’une grève générale féministe qui dessine la possibilité d’une autre organisation de toute la société ?